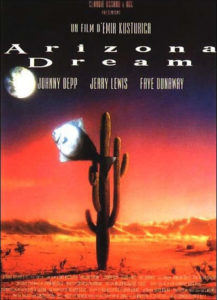J’ai trop souvent défendu, flamberge au vent et étendard déployé, le cinéma de Kusturica pour ne pas m’arroger le droit de dire tout le mal que je pense de cet étrange machin qui me semble très extérieur à l’œuvre du réalisateur, bien qu’on puisse juger qu’il en présente, superficiellement, toutes les apparences, et même tous les tics (par exemple la constance de la présence d’animaux, ici poissons, chiens de traîneaux, porcelet, tortues), que le jeu des acteurs soit, comme de coutume, survitaminé, que la musique soit de Goran Bregovic et qu’on y trouve, ici et là, ces images étranges et magnifiques qui fascinent tant dans d’autres réalisations (ici les limousines présentées sur des sortes de pilotis, l’embrasement final de l’arbre devant qui ondoie le poisson volant, par exemple).
pour ne pas m’arroger le droit de dire tout le mal que je pense de cet étrange machin qui me semble très extérieur à l’œuvre du réalisateur, bien qu’on puisse juger qu’il en présente, superficiellement, toutes les apparences, et même tous les tics (par exemple la constance de la présence d’animaux, ici poissons, chiens de traîneaux, porcelet, tortues), que le jeu des acteurs soit, comme de coutume, survitaminé, que la musique soit de Goran Bregovic et qu’on y trouve, ici et là, ces images étranges et magnifiques qui fascinent tant dans d’autres réalisations (ici les limousines présentées sur des sortes de pilotis, l’embrasement final de l’arbre devant qui ondoie le poisson volant, par exemple).
 Après avoir reçu, au festival de Cannes, la Palme d’or pour Papa est en voyage d’affaires
Après avoir reçu, au festival de Cannes, la Palme d’or pour Papa est en voyage d’affaires et le prix de la mise en scène pour Le temps des gitans
et le prix de la mise en scène pour Le temps des gitans , Kusturica
, Kusturica est sollicité pour tourner un film aux États-Unis. Je suppose que ce genre d’apparente aubaine ne se refuse pas souvent, surtout si la distribution comporte des vedettes de première magnitude, comme Faye Dunaway
est sollicité pour tourner un film aux États-Unis. Je suppose que ce genre d’apparente aubaine ne se refuse pas souvent, surtout si la distribution comporte des vedettes de première magnitude, comme Faye Dunaway et Johnny Depp
et Johnny Depp ou une momie célèbre, comme Jerry Lewis
ou une momie célèbre, comme Jerry Lewis .
.
Le premier malheur est que le film, conçu en 90-91 se tourne aux pires moments du conflit dans les territoires de l’ex-Yougoslavie, : la Bosnie-Herzégovine proclame unilatéralement son indépendance en octobre 91 et cette autoproclamation est bizarrement reconnue par les États-Unis et l’Europe en avril 92. Dès lors la guerre civile éclate, les massacres commencent, les déplacements de population prennent de l’ampleur. On peut comprendre que les déchirements d’un pays si singulier, mais à qui Kusturica était fondamentalement attaché, les craintes pour les siens, l’écroulement des illusions d’un destin collectif aient profondément perturbé le cinéaste.
était fondamentalement attaché, les craintes pour les siens, l’écroulement des illusions d’un destin collectif aient profondément perturbé le cinéaste.
 Mais tout autant, précisément, on peut se demander si la transposition des merveilleuses folies balkaniques dans un Arizona sans histoire ancestrale, avec des acteurs imbibés jusqu’au fond d’eux-mêmes du rêve américain était une bonne idée. Un réalisateur aussi empreint et marqué par son appartenance territoriale, par la civilisation de son peuple que Kusturica
Mais tout autant, précisément, on peut se demander si la transposition des merveilleuses folies balkaniques dans un Arizona sans histoire ancestrale, avec des acteurs imbibés jusqu’au fond d’eux-mêmes du rêve américain était une bonne idée. Un réalisateur aussi empreint et marqué par son appartenance territoriale, par la civilisation de son peuple que Kusturica peut-il, sans risque pour sa propre cohérence, tourner quelque chose qui atteigne la même dimension universelle que les films de son enracinement ? Allez faire tourner à Pagnol
peut-il, sans risque pour sa propre cohérence, tourner quelque chose qui atteigne la même dimension universelle que les films de son enracinement ? Allez faire tourner à Pagnol , à Guitry
, à Guitry des films qui ne soient pas empreints de l’esprit de Provence pour l’un, de l’esprit de Paris, pour l’autre…. Et je gagerai volontiers que les films les plus importants de Renoir
des films qui ne soient pas empreints de l’esprit de Provence pour l’un, de l’esprit de Paris, pour l’autre…. Et je gagerai volontiers que les films les plus importants de Renoir ne sont pas ceux de sa période étasunienne…
ne sont pas ceux de sa période étasunienne…
 C’est là un débat que nous avons eu, de temps en temps et qui est, de ma part, davantage une position stable qu’une certitude, mais dont j’attends encore les contre-arguments… Toujours est-il que ne suis pas entré du tout dans Arizona dream
C’est là un débat que nous avons eu, de temps en temps et qui est, de ma part, davantage une position stable qu’une certitude, mais dont j’attends encore les contre-arguments… Toujours est-il que ne suis pas entré du tout dans Arizona dream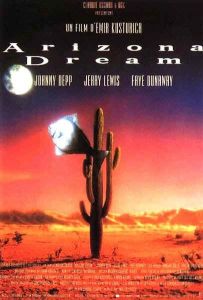 , n’ai trouvé aucune pertinence, aucune cohérence, aucun intérêt aux trépignements des protagonistes d’un film qui dure bien trop longtemps sans jamais qu’on n’y trouve les miraculeuses parcelles d’émotion si présentes dans Underground
, n’ai trouvé aucune pertinence, aucune cohérence, aucun intérêt aux trépignements des protagonistes d’un film qui dure bien trop longtemps sans jamais qu’on n’y trouve les miraculeuses parcelles d’émotion si présentes dans Underground , Chat noir, chat blanc
, Chat noir, chat blanc ou La vie est un miracle
ou La vie est un miracle .
.