Guère convaincu davantage par Colonel Blimp que par Les chaussons rouges
que par Les chaussons rouges sur la qualité extrême de talent que beaucoup prêtent à Michael Powell
sur la qualité extrême de talent que beaucoup prêtent à Michael Powell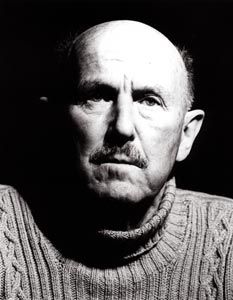 et qui lui a valu une édition DVD absolument remarquable, non seulement avec image et son nettoyés, mais avec un luxe de présentation rare (un deuxième DVD de bonus, un livret très complet, très bien illustré) ; si tous les grands noms du cinéma pouvaient bénéficier d’un tel respect, d’une telle ferveur ! Je suis le premier à admettre que Powell
et qui lui a valu une édition DVD absolument remarquable, non seulement avec image et son nettoyés, mais avec un luxe de présentation rare (un deuxième DVD de bonus, un livret très complet, très bien illustré) ; si tous les grands noms du cinéma pouvaient bénéficier d’un tel respect, d’une telle ferveur ! Je suis le premier à admettre que Powell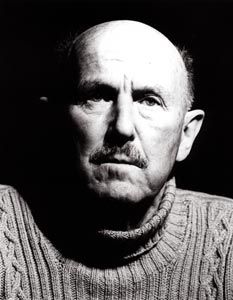 est un cinéaste de grand talent et que ses prises de vue, originales et travaillées, sont la plupart du temps absolument magnifiques, que la caméra est maniée avec une virtuosité exceptionnelle, que le choix des couleurs et des atmosphères est une marque de qualité supérieure. Je ne suis d’ailleurs pas réticent à l’idée de regarder le film une deuxième fois pour mieux encore en admirer les richesses visuelles.
est un cinéaste de grand talent et que ses prises de vue, originales et travaillées, sont la plupart du temps absolument magnifiques, que la caméra est maniée avec une virtuosité exceptionnelle, que le choix des couleurs et des atmosphères est une marque de qualité supérieure. Je ne suis d’ailleurs pas réticent à l’idée de regarder le film une deuxième fois pour mieux encore en admirer les richesses visuelles.
 Les sujets abordés dans Colonel Blimp
Les sujets abordés dans Colonel Blimp , qui touchent à la fois à l’histoire du demi vingtième siècle et à l’amitié enracinée entre deux êtres que cette même histoire place dans des camps ennemis me parlent aussi infiniment plus que ne l’a fait le mélodrame ennuyeux et prévisible des Chaussons rouges
, qui touchent à la fois à l’histoire du demi vingtième siècle et à l’amitié enracinée entre deux êtres que cette même histoire place dans des camps ennemis me parlent aussi infiniment plus que ne l’a fait le mélodrame ennuyeux et prévisible des Chaussons rouges ; question de sensibilité et de centres d’intérêt.
; question de sensibilité et de centres d’intérêt.
Mais je ne me suis pas laissé emporter par Colonel Blimp , trouvant cela trop long, emberlificoté, farfelu, extrêmement anglais en quelque sorte, contraste de scènes bouffonnes et de moments graves et tendus.
, trouvant cela trop long, emberlificoté, farfelu, extrêmement anglais en quelque sorte, contraste de scènes bouffonnes et de moments graves et tendus.
 On me dira que le contraste entre le drame et la comédie est l’essence même de beaucoup des films italiens que j’aime où le rire et les larmes se tutoient ; sans doute, mais il y a, sans que je puisse l’expliquer, un gouffre entre ces cinémas-là ; en tout cas je suis en parenté intellectuelle avec les uns, et guère avec les autres. Le burlesque n’est pas mon truc (d’ailleurs quand, naïvement, je regarde le mot sur Wikipédia, les exemples de cinéastes sont des gens que je déteste vraiment, des comiques muets américains à Jacques Tati
On me dira que le contraste entre le drame et la comédie est l’essence même de beaucoup des films italiens que j’aime où le rire et les larmes se tutoient ; sans doute, mais il y a, sans que je puisse l’expliquer, un gouffre entre ces cinémas-là ; en tout cas je suis en parenté intellectuelle avec les uns, et guère avec les autres. Le burlesque n’est pas mon truc (d’ailleurs quand, naïvement, je regarde le mot sur Wikipédia, les exemples de cinéastes sont des gens que je déteste vraiment, des comiques muets américains à Jacques Tati et Pierre Etaix
et Pierre Etaix en passant par Jerry Lewis
en passant par Jerry Lewis ).
).
 Bon, donc, toutes les scènes à prétention comique – le motocycliste qui apporte les ordres nécessaires à l’exercice de défense civile dirigé par le général Clive Wynne-Candy (Roger Livesey
Bon, donc, toutes les scènes à prétention comique – le motocycliste qui apporte les ordres nécessaires à l’exercice de défense civile dirigé par le général Clive Wynne-Candy (Roger Livesey ), les scènes au hammam du même général, celles où le fidèle serviteur Murdoch (John Laurie
), les scènes au hammam du même général, celles où le fidèle serviteur Murdoch (John Laurie ) joue l’ahuri – me laissent sceptique et pantois ; les scènes dramatiques, ou, simplement, sérieuses, sont, pour beaucoup d’entre elles, d’une grande qualité, parfois même très nobles, en premier lieu celles où l’impeccable Anton Walbrook
) joue l’ahuri – me laissent sceptique et pantois ; les scènes dramatiques, ou, simplement, sérieuses, sont, pour beaucoup d’entre elles, d’une grande qualité, parfois même très nobles, en premier lieu celles où l’impeccable Anton Walbrook (Theo Kretschmar-Schuldorff, l’ami allemand), au delà de son talent, exprime ses inquiétudes et son angoisse devant le sort du monde.
(Theo Kretschmar-Schuldorff, l’ami allemand), au delà de son talent, exprime ses inquiétudes et son angoisse devant le sort du monde.
 Je dois dire que je ne partage pas vraiment le point de vue du couple Powell
Je dois dire que je ne partage pas vraiment le point de vue du couple Powell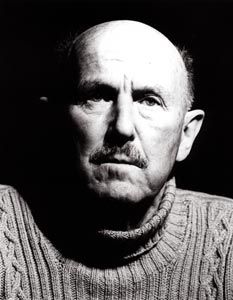 /Pressburger
/Pressburger sur le caractère spécifique et aberrant de la période nazie dans le lourd passé de l’Allemagne unie. Le nazisme me paraît l’avatar le plus monstrueux, mais aussi le plus accompli du caractère absolument fou de l’Allemagne unie. Déjà, au cours de la Première guerre le bombardement totalement injustifié, sans aucune autre visée stratégique que la volonté de destruction du symbole, de la Cathédrale de Reims avait jeté le Monde civilisé dans l’opprobre et la stupeur… Le torpillage du paquebot civil Lusitania en mai 1915 (12OO morts) ne fut pas pour rien dans l’entrée en guerre des États-Unis, farouchement isolationnistes, mais qui ne pouvaient plus supporter l’arrogance germanique… et tant d’autres exemples… Enfin, en 1942-43, Blimp
sur le caractère spécifique et aberrant de la période nazie dans le lourd passé de l’Allemagne unie. Le nazisme me paraît l’avatar le plus monstrueux, mais aussi le plus accompli du caractère absolument fou de l’Allemagne unie. Déjà, au cours de la Première guerre le bombardement totalement injustifié, sans aucune autre visée stratégique que la volonté de destruction du symbole, de la Cathédrale de Reims avait jeté le Monde civilisé dans l’opprobre et la stupeur… Le torpillage du paquebot civil Lusitania en mai 1915 (12OO morts) ne fut pas pour rien dans l’entrée en guerre des États-Unis, farouchement isolationnistes, mais qui ne pouvaient plus supporter l’arrogance germanique… et tant d’autres exemples… Enfin, en 1942-43, Blimp luttait pour la bonne cause, c’est déjà ça, mais on comprend que Churchill ait plutôt souhaité mettre des bâtons dans les roues du duo de cinéastes…
luttait pour la bonne cause, c’est déjà ça, mais on comprend que Churchill ait plutôt souhaité mettre des bâtons dans les roues du duo de cinéastes…
 Ah… Et puis les aventures féminines des protagonistes du film – disons plutôt leurs histoires d’amour – me semblent également totalement plaquées et parfaitement artificielles, même si le frais minois de Deborah Kerr
Ah… Et puis les aventures féminines des protagonistes du film – disons plutôt leurs histoires d’amour – me semblent également totalement plaquées et parfaitement artificielles, même si le frais minois de Deborah Kerr dans un triple rôle, n’est pas désagréable à regarder…
dans un triple rôle, n’est pas désagréable à regarder…
