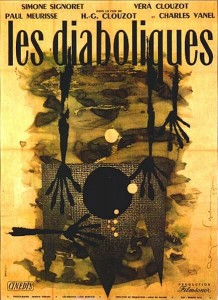Il y a encore et toujours de quoi écrire sur Les Diaboliques, qui est vraiment une parfaite réussite, au delà de ses invraisemblances, qu’on ne remarque guère, toutefois, que lorsque l’on a vu plusieurs fois le film et que l’on peut fixer plus calmement son attention sur les développements et les ressorts de l’intrigue. Et parfaite réussite dès le générique, qui est pourtant un seul plan fixe : l’image de la piscine visqueuse, huileuse, sale, gluante, envahie par les algues, sur quoi tombe une méchante petite pluie de printemps ; tout cela sur une musique déchirée de Georges van Parys qu’on n’entendra plus qu’à la fin.
Une partie de la qualité du film est l’intégration très réussie par Clouzot de plusieurs thèmes qui s’enchâssent, se répondent et dialoguent intelligemment jusqu’à ce que la nécessité de la révélation terminale avec sa machinerie horrifique prenne un peu trop le devant de la scène (mais les ultimes images et leurs formidables ambiguïtés rehaussent cette toute petite baisse de niveau).
 D’abord le monde si particulier des internats privés où des milieux plutôt aisés plaçaient à grand frais des rejetons généralement peu doués pour les études ou particulièrement indisciplinés. Avant la loi Debré de 1959, qui leur octroya sous contrat des aides publiques, ces établissements avaient toute latitude dans le choix des programmes et la sélection des enseignants. D’où le ramassis singulier de professeurs insolites, dépourvus de diplômes ou affligés de tares douteuses qu’on y trouvait (revoir Les disparus de Saint Agil ou Topaze). Dans Les Diaboliques, certaines des meilleures séquences sont celles des relations obséquieuses entretenues par le personnel du collège (Pierre Larquey, extraordinaire, Michel Serrault et l’homme de peine Jean Brochard) avec son tyrannique directeur Michel Delasalle (Paul Meurisse, un soupçon trop âgé pour le rôle : censé avoir 34 ans, il en avait déjà 42).
D’abord le monde si particulier des internats privés où des milieux plutôt aisés plaçaient à grand frais des rejetons généralement peu doués pour les études ou particulièrement indisciplinés. Avant la loi Debré de 1959, qui leur octroya sous contrat des aides publiques, ces établissements avaient toute latitude dans le choix des programmes et la sélection des enseignants. D’où le ramassis singulier de professeurs insolites, dépourvus de diplômes ou affligés de tares douteuses qu’on y trouvait (revoir Les disparus de Saint Agil ou Topaze). Dans Les Diaboliques, certaines des meilleures séquences sont celles des relations obséquieuses entretenues par le personnel du collège (Pierre Larquey, extraordinaire, Michel Serrault et l’homme de peine Jean Brochard) avec son tyrannique directeur Michel Delasalle (Paul Meurisse, un soupçon trop âgé pour le rôle : censé avoir 34 ans, il en avait déjà 42).
 Autre thème, flamboyant et sulfureux, qui s’éclaire davantage encore lorsque l’on a quelques lumières sur les orientations érotiques de Clouzot (voir, si l’on est curieux, La Prisonnière) et son sadisme notoire vis-à-vis de ses acteurs (sa femme Véra, mais aussi Cécile Aubry dans Manon ou Brigitte Bardot dans La vérité). À l’époque (serait-ce d’ailleurs vraiment différent aujourd’hui ?), le triangle sexuel (je n’écris évidemment pas triangle amoureux) formé par Delassalle/Meurisse, sa femme Christina/Véra Clouzot et leur maîtresse Nicole Horner/Simone Signoret avait fait scandale. Et si j’ai écrit leur maîtresse, c’est que, sauf à ne pas voir l’évidence, la relation homosexuelle des deux femmes ne fait pas de doute. Pas davantage que le masochisme de Christina et l’impact charnel qu’exerce Delassalle sur les femmes (brève séquence dans le train qui le conduit à Niort, où il capte le regard d’une oie blanche).
Autre thème, flamboyant et sulfureux, qui s’éclaire davantage encore lorsque l’on a quelques lumières sur les orientations érotiques de Clouzot (voir, si l’on est curieux, La Prisonnière) et son sadisme notoire vis-à-vis de ses acteurs (sa femme Véra, mais aussi Cécile Aubry dans Manon ou Brigitte Bardot dans La vérité). À l’époque (serait-ce d’ailleurs vraiment différent aujourd’hui ?), le triangle sexuel (je n’écris évidemment pas triangle amoureux) formé par Delassalle/Meurisse, sa femme Christina/Véra Clouzot et leur maîtresse Nicole Horner/Simone Signoret avait fait scandale. Et si j’ai écrit leur maîtresse, c’est que, sauf à ne pas voir l’évidence, la relation homosexuelle des deux femmes ne fait pas de doute. Pas davantage que le masochisme de Christina et l’impact charnel qu’exerce Delassalle sur les femmes (brève séquence dans le train qui le conduit à Niort, où il capte le regard d’une oie blanche).
 Troisième orientation : l’intrigue meurtrière proprement dite, qui s’engage avec le voyage à Niort, dont était originaire Clouzot, Niort filmée sans complaisance et même avec un certain mépris. Province, désert sans solitude, selon le mot de François Mauriac, rues pavées étroites et rancies, couple effarant de mesquinerie (et délicieux de talent, Noël Roquevert et Thérèse Dorny), appartement mesquin. Delassalle boit son whisky drogué (ou non ?) comme si c’était du vin, et l’on perçoit bien là combien ce breuvage, en 54, était presque exotique (d’ailleurs Nicole le dit : Je n’en ai jamais bu). Violence de l’assassinat. Retour à Saint-Cloud.
Troisième orientation : l’intrigue meurtrière proprement dite, qui s’engage avec le voyage à Niort, dont était originaire Clouzot, Niort filmée sans complaisance et même avec un certain mépris. Province, désert sans solitude, selon le mot de François Mauriac, rues pavées étroites et rancies, couple effarant de mesquinerie (et délicieux de talent, Noël Roquevert et Thérèse Dorny), appartement mesquin. Delassalle boit son whisky drogué (ou non ?) comme si c’était du vin, et l’on perçoit bien là combien ce breuvage, en 54, était presque exotique (d’ailleurs Nicole le dit : Je n’en ai jamais bu). Violence de l’assassinat. Retour à Saint-Cloud.
Puis irruption d’un commissaire à la retraite fouineur et matois, Alfred Fichet/Charles Vanel. Je suis moins satisfait du film, à partir de ce moment-là, le trouvant plus banal et plus convenu, malgré la scène surréaliste de la chambre du meublé où le valet de chambre (Jean Temerson) brouille les pistes (Personne n’a jamais vu M. Delassalle). Et les dernières séquences, ombres angoissantes, rais de lumière sous les portes, grincements, bruits étranges, hurlements. Du Mario Bava qui ne s’insère pas parfaitement dans le puzzle… Jusqu’à cette fin incertaine et presque ouverte.
Et finalement ces Diaboliques demeurent haletantes jusqu’au bout, surprenantes, angoissantes, terrifiantes. On a beau les voir et revoir, on s’y laisse toujours prendre.