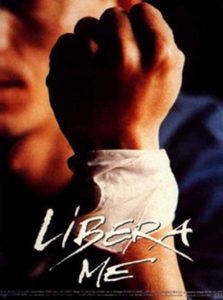J’ai assez célébré ici les films d’Alain Cavalier , les plus accessibles (La chamade
, les plus accessibles (La chamade ou même Le combat dans l’île
ou même Le combat dans l’île ), les plus austères (Thérèse
), les plus austères (Thérèse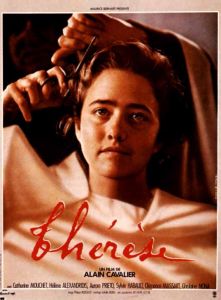 ), les plus délicats (24 portraits
), les plus délicats (24 portraits ) et même les plus compliqués (Le filmeur
) et même les plus compliqués (Le filmeur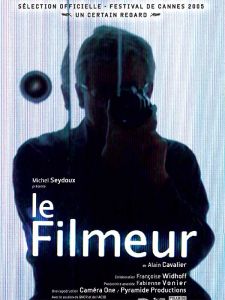 ) pour avoir le droit de ne pas dire du bien de cet exercice assez vain qu’est Libera me
) pour avoir le droit de ne pas dire du bien de cet exercice assez vain qu’est Libera me .
.
Tourner une parabole de l’oppression, essayer d’en montrer la pesanteur, la dureté, la méchanceté intrinsèques n’est pas sans qualité et moins encore de ne pas coller de dialogue à cette métaphore de l’horreur, de façon à, si je puis dire l’intemporaliser, la rendre efficace pour tous les âges et toutes les sociétés. On peut accoler les images à l’Allemagne nazie, à la Russie communiste et, par dérivation, à tous les régimes autoritaires. Dans tous ceux là la honte, l’angoisse, la lâcheté, la cruauté, le mépris, l’humiliation…
Filmer en plans moyens, avec des fonds d’image ternes, anonymes, sans relief n’est pas non plus une mauvaise idée : cela démontre seulement la banalité du Mal, son aversion du spectaculaire.
 Mais c’est long. Et ce qui serait un parfait court métrage, même s’il n’en est qu’un moyen (1 heure un quart), tourne un peu en rond et confine à la performance. On ne voit pas trop ce que la répétition des séquences apporte, sinon la démonstration de la virtuosité de Cavalier
Mais c’est long. Et ce qui serait un parfait court métrage, même s’il n’en est qu’un moyen (1 heure un quart), tourne un peu en rond et confine à la performance. On ne voit pas trop ce que la répétition des séquences apporte, sinon la démonstration de la virtuosité de Cavalier . C’est insuffisant.
. C’est insuffisant.
Il y a un très froid roman de Georges Simenon intitulé La neige était sale qui utilise ces thématiques ; j’aimerais bien voir le film
intitulé La neige était sale qui utilise ces thématiques ; j’aimerais bien voir le film que Luis Saslavsky en a tiré en 1952. La comparaison ne serait pas inutile, sans doute.
que Luis Saslavsky en a tiré en 1952. La comparaison ne serait pas inutile, sans doute.