
Le dernier grand film de Duvivier
Marie-Octobre est le chant du cygne, ou plutôt le dernier chef-d’œuvre de l’extraordinaire carrière de Julien Duvivier
est le chant du cygne, ou plutôt le dernier chef-d’œuvre de l’extraordinaire carrière de Julien Duvivier qui s’étend sur près de cinquante ans, qui a touché une variété de registres peu imaginable aujourd’hui, où les cinéastes s’enferment volontiers dans un genre, parce qu’ils craignent, ou négligent d’ouvrir leur palette (je ne vois guère, de nos jours, en France, que l’excellent mais très inégal Patrice Leconte
qui s’étend sur près de cinquante ans, qui a touché une variété de registres peu imaginable aujourd’hui, où les cinéastes s’enferment volontiers dans un genre, parce qu’ils craignent, ou négligent d’ouvrir leur palette (je ne vois guère, de nos jours, en France, que l’excellent mais très inégal Patrice Leconte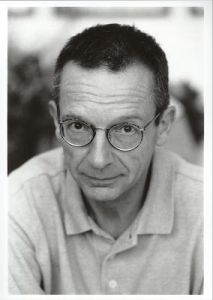 qui ait le goût boulimique de toucher à tout, de la farce au drame, du film noir au conte de fée).
qui ait le goût boulimique de toucher à tout, de la farce au drame, du film noir au conte de fée).
Dernier chef-d’œuvre, parce que les quelques films qui vont suivre, notamment Le Diable et les Dix commandements et surtout Diaboliquement vôtre
et surtout Diaboliquement vôtre laisseront aux admirateurs du réalisateur l’impression pénible d’une décadence, d’une dégénérescence absolue, comme peut laisser un aîné, un grand-père qu’on a beaucoup admiré, et qu’on voit s’enfoncer dans le gâtisme.
laisseront aux admirateurs du réalisateur l’impression pénible d’une décadence, d’une dégénérescence absolue, comme peut laisser un aîné, un grand-père qu’on a beaucoup admiré, et qu’on voit s’enfoncer dans le gâtisme.
Dernier chef-d’œuvre, mais, donc, dernier des chefs-d’œuvre : si un cinéaste a concentré, dans ses plus belles années, une collection de merveilles, c’est bien Duvivier :
:
1935 : La Bandera , le romantisme de la Légion (espagnole) et la guerre du Rif ;
, le romantisme de la Légion (espagnole) et la guerre du Rif ;
1936 : La belle équipe , miraculeuse captation de l’allégresse du Front Populaire (ça se termine, d’ailleurs, aussi mal !) ;
, miraculeuse captation de l’allégresse du Front Populaire (ça se termine, d’ailleurs, aussi mal !) ;
1937 : Pepe le Moko , mauvais garçons, exotisme et amours impossibles ;
, mauvais garçons, exotisme et amours impossibles ;
et aussi Un carnet de bal , brillantissime film à sketches (qui n’a jamais entendu Jouvet
, brillantissime film à sketches (qui n’a jamais entendu Jouvet dire du Verlaine (Dans le vieux parc solitaire et glacé…) est bien à plaindre !) ;
dire du Verlaine (Dans le vieux parc solitaire et glacé…) est bien à plaindre !) ;
1939 : La fin du jour , film le plus sordide qui se puisse sur la vieillesse et le cabotinage…
, film le plus sordide qui se puisse sur la vieillesse et le cabotinage…
Après la guerre, c’est un peu plus inégal, mais avec de merveilleux éclats :
1946 : Panique , exceptionnelle adaptation de Simenon
, exceptionnelle adaptation de Simenon (Les fiançailles de M. Hire) ;
(Les fiançailles de M. Hire) ;
1951 : Sous le ciel de Paris , destins croisés, film tout autant cruel que tendre (et qui vient – quel bonheur ! – de sortir en DVD, hélas, chez René Château !) ;
, destins croisés, film tout autant cruel que tendre (et qui vient – quel bonheur ! – de sortir en DVD, hélas, chez René Château !) ;
1952 et 1953 : les deux premiers – et les meilleurs ! – Don Camillo , véritables mythes d’un cinéma à la fois comique et profondément enraciné dans la réalité ;
, véritables mythes d’un cinéma à la fois comique et profondément enraciné dans la réalité ;
1956 : Voici le temps des assassins , la noirceur la plus absolue et la plus désespérante ;
, la noirceur la plus absolue et la plus désespérante ;
1957 : Pot-Bouille , un des meilleurs rôles de Gérard Philipe
, un des meilleurs rôles de Gérard Philipe – qui n’en eût pas tant que ça au cinéma ! – et une remarquable adaptation de Zola
– qui n’en eût pas tant que ça au cinéma ! – et une remarquable adaptation de Zola
et aussi L’homme à l’imperméable mélange très réussi entre le grotesque et le glaçant, déstabilisation cauchemardesque d’un brave type qui préfigure, avec trente ans d’avance, l’After hours
mélange très réussi entre le grotesque et le glaçant, déstabilisation cauchemardesque d’un brave type qui préfigure, avec trente ans d’avance, l’After hours de Martin Scorsese
de Martin Scorsese …
…
Et donc, en 1959, cette Marie-Octobre , qui revient à une facture très classique, celle du huis clos, pour identifier, quinze ans après, un traître qui a donné aux Allemands le chef d’un réseau de Résistance, traître qui se trouve forcément parmi tous ceux qui sont là ce soir, grand bourgeois (Paul Meurisse
, qui revient à une facture très classique, celle du huis clos, pour identifier, quinze ans après, un traître qui a donné aux Allemands le chef d’un réseau de Résistance, traître qui se trouve forcément parmi tous ceux qui sont là ce soir, grand bourgeois (Paul Meurisse ), prêtre (Paul Guers
), prêtre (Paul Guers ), tenancier de boîte de nuit (Lino Ventura
), tenancier de boîte de nuit (Lino Ventura ), avocat (Bernard Blier
), avocat (Bernard Blier ), serrurier (Robert Dalban
), serrurier (Robert Dalban ), médecin (Daniel Ivernel), mandataire aux Halles (Paul Frankeur
), médecin (Daniel Ivernel), mandataire aux Halles (Paul Frankeur ), contrôleur des impôts (Noël Roquevert
), contrôleur des impôts (Noël Roquevert ), imprimeur (Serge Reggiani
), imprimeur (Serge Reggiani )… tout ce monde réuni autour de Marie-Octobre (Danielle Darrieux
)… tout ce monde réuni autour de Marie-Octobre (Danielle Darrieux ), lumineusement belle, égérie du groupe clandestin d’alors et alors maîtresse du chef trahi et assassiné.
), lumineusement belle, égérie du groupe clandestin d’alors et alors maîtresse du chef trahi et assassiné.
Caricatural, outré, participant de la légende dorée de la Résistance ?
Possible…Mais quelle efficacité ! Huis clos étouffant, dialogues étincelants, sens du suspense… J’ai vu dix fois le film et connais donc évidemment le nom du traître…Et pourtant à chaque fois, je me laisse prendre !