Oui, qu’est-ce qui manque pour que ce film charmant, sympathique, attachant, qu’on voie et revoie toujours avec plaisir atteigne le niveau de très bons films choraux, comme Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis
et Nous irons tous au paradis d’Yves Robert
d’Yves Robert ou du chef-d’œuvre, comme Mes chers amis
ou du chef-d’œuvre, comme Mes chers amis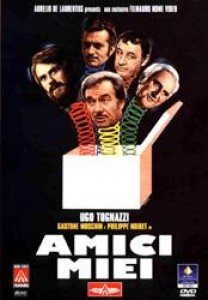 de Mario Monicelli
de Mario Monicelli ?
?
D’abord, il me semble, ça manque, à la fin, d’un peu de rythme, parce qu’il y a un quart d’heure en trop, que le réalisateur ne sait pas trop comment finir, ou qu’il a la fausse bonne idée de faire intervenir des personnages nouveaux assez insignifiants, les deux bourgeoises, l’une complètement émoustillée, l’autre coincée encore, Monique et Sabine (Elisabeth Margoni et Marie-France Duhoux) : leur irruption dans le cénacle composé des cinq copains et de leur ancienne égérie n’a pas vraiment de sens.
 L’ancienne égérie, Bernadette (Louise Portal
L’ancienne égérie, Bernadette (Louise Portal ) est aussi, à mes yeux, une des faiblesses du film ; en avoir fait une Québécoise est plutôt rigolo, et fait irrésistiblement penser à la grande perche Céline Dion
) est aussi, à mes yeux, une des faiblesses du film ; en avoir fait une Québécoise est plutôt rigolo, et fait irrésistiblement penser à la grande perche Céline Dion , d’autant que son mari-producteur-tyran domestique, joué avec son talent habituel par Didier Pain ressemble sans doute assez à ce René Angélil qui est, paraît-il le Pygmalion de la grande star (écrivant ceci, et devant mes totales ignorance et indifférence de et à cette chanteuse, je me demande si, en 1989, date de sortie du film, Céline Dion
, d’autant que son mari-producteur-tyran domestique, joué avec son talent habituel par Didier Pain ressemble sans doute assez à ce René Angélil qui est, paraît-il le Pygmalion de la grande star (écrivant ceci, et devant mes totales ignorance et indifférence de et à cette chanteuse, je me demande si, en 1989, date de sortie du film, Céline Dion chantait déjà ou, à tout le moins était connue ; si non peut-être alors le modèle de Bernadette Legranbois du film est-elle Diane Dufresne, qui me semble bien plus talentueuse ? Toujours est-il que Louise Portal
chantait déjà ou, à tout le moins était connue ; si non peut-être alors le modèle de Bernadette Legranbois du film est-elle Diane Dufresne, qui me semble bien plus talentueuse ? Toujours est-il que Louise Portal m’agace plutôt et qu’on ne comprend pas trop la fascination qu’elle a pu exercer sur le groupe et continuer à exercer sur certains).
m’agace plutôt et qu’on ne comprend pas trop la fascination qu’elle a pu exercer sur le groupe et continuer à exercer sur certains).
Mais la principale faiblesse, à mes yeux, est de rendre chacun trop clair, trop prévisible, sans mystère et, de ce fait, sans épaisseur : l’homosexualité de Daniel (Claude Brasseur ) dans les deux films d’Yves Robert
) dans les deux films d’Yves Robert , le comportement épouvantable de Lelio Maschetti (Ugo Tognazzi
, le comportement épouvantable de Lelio Maschetti (Ugo Tognazzi ) avec ses petites estivantes (sa femme et sa fille) ne sont pas d’emblée présentés comme des données et surviennent, en quelque sorte comme des révélations, qui donnent de l’épaisseur humaine, et du vrai pathétique au récit. Dans Mes meilleurs copains
) avec ses petites estivantes (sa femme et sa fille) ne sont pas d’emblée présentés comme des données et surviennent, en quelque sorte comme des révélations, qui donnent de l’épaisseur humaine, et du vrai pathétique au récit. Dans Mes meilleurs copains , tout est à peu près en place dès le début. Jean-Marie Poiré
, tout est à peu près en place dès le début. Jean-Marie Poiré se prive ainsi d’un détonateur dramatique fort.
se prive ainsi d’un détonateur dramatique fort.
 Cela écrit, on doit tout de même se laisser aller au charme d’une histoire construite, en 1989, avec de jubilatoires retours sur les billevesées gauchistes du début des années 70 : les communautés hippies, les élans vers les masses, la culture à l’usine, la destruction du discours théâtral, tout cela est vu avec rosserie et précision (comme dans les excellents Babas cool
Cela écrit, on doit tout de même se laisser aller au charme d’une histoire construite, en 1989, avec de jubilatoires retours sur les billevesées gauchistes du début des années 70 : les communautés hippies, les élans vers les masses, la culture à l’usine, la destruction du discours théâtral, tout cela est vu avec rosserie et précision (comme dans les excellents Babas cool de François Leterrier
de François Leterrier ) ; à l’exception d’un Clavier
) ; à l’exception d’un Clavier dont le rôle est plutôt mièvre, les autres copains sont parfaitement dessinés et méritent tous mention : Gérard Lanvin
dont le rôle est plutôt mièvre, les autres copains sont parfaitement dessinés et méritent tous mention : Gérard Lanvin , petit patron dur au boulot, (re)devenu assez beauf, dragueur d’habitude, Jean-Pierre Darroussin
, petit patron dur au boulot, (re)devenu assez beauf, dragueur d’habitude, Jean-Pierre Darroussin , hippie lunaire, pique-assiette délicieux et attendrissant d’irresponsabilité, Philippe Khorsand
, hippie lunaire, pique-assiette délicieux et attendrissant d’irresponsabilité, Philippe Khorsand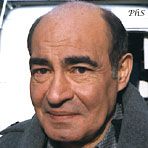 , geignard, grognon, irascible metteur en scène d’avant-garde aux angoisses terriblement bourgeoises, Jean-Pierre Bacri
, geignard, grognon, irascible metteur en scène d’avant-garde aux angoisses terriblement bourgeoises, Jean-Pierre Bacri , homosexuel ascète, qui n’a « plus fait l’amour depuis 1983 », torturant son corps dans le sport et la frustration, et manque pourtant de succomber à ses tentations… Tous sont intéressants…
, homosexuel ascète, qui n’a « plus fait l’amour depuis 1983 », torturant son corps dans le sport et la frustration, et manque pourtant de succomber à ses tentations… Tous sont intéressants…
C’est bien, c’est plaisant ; ça vaut la peine d’être revu…

