Ah, mon Dieu, que c’est bien et comme ça me fait, sûrement un peu abusivement, hausser ma note, sans être tout à fait dupe, mais en demeurant persuadé que ce cinéma-là, celui de la douceur des villages, était un trésor, tout de finesse, d’émotion, de regard tendre, amusé, et quelquefois presque ému sur un monde désormais clos, mais qui a été le décor paisible de la France d’hier…
 Pleure pas la bouche pleine
Pleure pas la bouche pleine , c’est encore mieux que Les Zozos
, c’est encore mieux que Les Zozos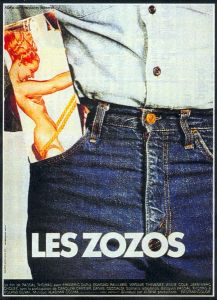 , encore plus complice, plus connivent, plus proche; c’est la France des meules de foin propices aux embrassades adolescentes et aux émois plus troubles, la France de la feuille de route du service militaire, qui a été un des rituels les plus forts pour mêler et se faire comprendre les générations, de la fleur amoureuse qu’on cueillait souvent avant d’accomplir ces douze (seize, vingt-quatre, trente-six mois) dans les casernes de l’Est, la France de la campagne encore habitée, de la messe du dimanche, seule occasion des femmes, toujours vouées au travail continu, de s’habiller un peu et de délaisser ménage, repassage, cuisine et lessive….
, encore plus complice, plus connivent, plus proche; c’est la France des meules de foin propices aux embrassades adolescentes et aux émois plus troubles, la France de la feuille de route du service militaire, qui a été un des rituels les plus forts pour mêler et se faire comprendre les générations, de la fleur amoureuse qu’on cueillait souvent avant d’accomplir ces douze (seize, vingt-quatre, trente-six mois) dans les casernes de l’Est, la France de la campagne encore habitée, de la messe du dimanche, seule occasion des femmes, toujours vouées au travail continu, de s’habiller un peu et de délaisser ménage, repassage, cuisine et lessive….
Tout le monde joue miraculeusement juste, dans Pleure pas la bouche pleine , les grands acteurs connus, Jean Carmet
, les grands acteurs connus, Jean Carmet , merveilleux tyran domestique, plein d’amour pour sa femme et ses filles, Daniel Ceccaldi
, merveilleux tyran domestique, plein d’amour pour sa femme et ses filles, Daniel Ceccaldi qui, je le concède, n’intervient que dans moins une dizaine de minutes, mais dont la présence, en parrain rigolard, veule, vulgaire, au gosier en pente et aux mains baladeuses est une si belle création qu’on ne peut le confiner dans un si petit rôle…
qui, je le concède, n’intervient que dans moins une dizaine de minutes, mais dont la présence, en parrain rigolard, veule, vulgaire, au gosier en pente et aux mains baladeuses est une si belle création qu’on ne peut le confiner dans un si petit rôle…
 Les grands acteurs connus mais aussi les autres, qui emplissent l’espace et qui pourtant n’ont pas fait, ou si peu, un bout de carrière : Frédéric Duru, déjà premier rôle des Zozos
Les grands acteurs connus mais aussi les autres, qui emplissent l’espace et qui pourtant n’ont pas fait, ou si peu, un bout de carrière : Frédéric Duru, déjà premier rôle des Zozos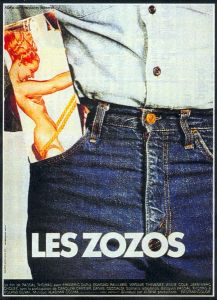 et qui a vite arrêté d’être acteur pour devenir chef décorateur, Friquette Thévenet, jolie petite fille à l’aube de l’adolescence, Isabelle Ganz, Geneviève, l’amie flirteuse d’Annie… Et Annie, précisément, Annie Colé, déjà parfaite dans Les Zozos
et qui a vite arrêté d’être acteur pour devenir chef décorateur, Friquette Thévenet, jolie petite fille à l’aube de l’adolescence, Isabelle Ganz, Geneviève, l’amie flirteuse d’Annie… Et Annie, précisément, Annie Colé, déjà parfaite dans Les Zozos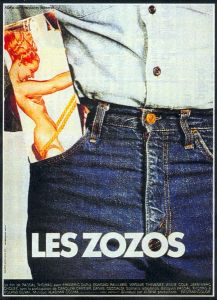 et qui, là, est d’une qualité de jeu, d’une vivacité, d’une sensibilité si exceptionnelle (ah, ces yeux vides, pendant qu’elle fait, pour la première fois, l’amour avec l’insupportable Alexandre (Bernard Menez), qui se brosse les dents, se désodorise, et fait sa petite toilette dans les moments attendrissants et pathétiques où la jeune fille se donne et voudrait tout de même un peu davantage)…
et qui, là, est d’une qualité de jeu, d’une vivacité, d’une sensibilité si exceptionnelle (ah, ces yeux vides, pendant qu’elle fait, pour la première fois, l’amour avec l’insupportable Alexandre (Bernard Menez), qui se brosse les dents, se désodorise, et fait sa petite toilette dans les moments attendrissants et pathétiques où la jeune fille se donne et voudrait tout de même un peu davantage)…
Bernard Menez entamait dans Pleure pas la bouche pleine une carrière fulgurante ; si fulgurante, d’ailleurs, qu’elle fit Pschitt juste après le film suivant de Pascal Thomas
une carrière fulgurante ; si fulgurante, d’ailleurs, qu’elle fit Pschitt juste après le film suivant de Pascal Thomas , qui s’appelle Le chaud lapin
, qui s’appelle Le chaud lapin , où il fut parfait, avant de se perdre complétement et de se retrouver dans un assez triste décalage, il y a quelques années comme inspiré par une vocation politique à géométrie bizarre…
, où il fut parfait, avant de se perdre complétement et de se retrouver dans un assez triste décalage, il y a quelques années comme inspiré par une vocation politique à géométrie bizarre…
 Pleure pas la bouche pleine
Pleure pas la bouche pleine est empli de notations justes, les filles qui apprennent la sténo-dactylo et qui mentent sur leur scolarité, les médecins de famille qui se relevaient la nuit pour soigner une fièvre bénigne, l’ennui des rues mornes des petits bourgs de province (- On est bien libre de faire ce qu’on veut ! – Qu’est-ce qu’on fait ?), les fous rires des filles, les chaussettes noires portées dans les spartiates des vacanciers qui partaient pour la Costa Brava, les mornifles, qu’on acceptait sans barguigner, des pères soucieux et aimants, les mères complices et presque envieuses des histoires d’amour de leurs filles, la paix tranquille d’un monde qui a disparu…
est empli de notations justes, les filles qui apprennent la sténo-dactylo et qui mentent sur leur scolarité, les médecins de famille qui se relevaient la nuit pour soigner une fièvre bénigne, l’ennui des rues mornes des petits bourgs de province (- On est bien libre de faire ce qu’on veut ! – Qu’est-ce qu’on fait ?), les fous rires des filles, les chaussettes noires portées dans les spartiates des vacanciers qui partaient pour la Costa Brava, les mornifles, qu’on acceptait sans barguigner, des pères soucieux et aimants, les mères complices et presque envieuses des histoires d’amour de leurs filles, la paix tranquille d’un monde qui a disparu…
 Un tendre et frais bijou.
Un tendre et frais bijou.