
Immense film !
Il est certain que je n’ai pas vu Quand passent les cigognes lorsqu’il est sorti en France ; je crois que j’ai déjà eu l’occasion d’écrire, à propos de je ne sais plus qui, ou quoi, que, dans les années Soixante, aller voir un film soviétique relevait davantage de l’acte militant que de la démarche cinéphilique ; si on n’était pas membre de « France-URSS » ou d’un ciné-club engagé quelconque, on s’abstenait. Eh oui ! Les clivages étaient lourds et les jeunes pousses n’imaginent sûrement pas ce qu’était, en France, l’atmosphère de la Guerre froide, et notamment pour ce que j’en ai connu, entre 1956 (Budapest) et 1968 (Prague). La moindre part de talent concédée à l’autre camp vous faisait regarder d’un drôle d’air par ceux dont vous étiez idéologiquement proche.
lorsqu’il est sorti en France ; je crois que j’ai déjà eu l’occasion d’écrire, à propos de je ne sais plus qui, ou quoi, que, dans les années Soixante, aller voir un film soviétique relevait davantage de l’acte militant que de la démarche cinéphilique ; si on n’était pas membre de « France-URSS » ou d’un ciné-club engagé quelconque, on s’abstenait. Eh oui ! Les clivages étaient lourds et les jeunes pousses n’imaginent sûrement pas ce qu’était, en France, l’atmosphère de la Guerre froide, et notamment pour ce que j’en ai connu, entre 1956 (Budapest) et 1968 (Prague). La moindre part de talent concédée à l’autre camp vous faisait regarder d’un drôle d’air par ceux dont vous étiez idéologiquement proche.
Et, violemment anticommuniste j’étais donc insusceptible de jamais regarder un film russe, ou bien hongrois, tchèque ou polonais. Outre que, depuis lors, j’ai mis beaucoup de vin (rouge) dans mon eau claire, l’effondrement du Rideau de fer m’a incité à découvrir l’âme slave – éternelle, celle-là, bien plus que les Soviets ! -et, sans en devenir passionné, et moins encore spécialiste, j’ai dû bien volontiers admettre qu’il y avait, à l’Est, de sacrés talents. Et s’il y a, en plus du discours patriote que j’aime, le frais minois de Tatyana Samojlova (en transcription graphique française, on disait plutôt Tatiana Samoïlova), mon syncrétisme d’aujourd’hui sera comblé !
———
J’y ai mis le temps, mais ça y est, je l’ai vu ! Et je suis emballé, ému, bouleversé même par ce film qui a accumulé les récompenses, à l’Est et à l’Ouest, mais qui n’a évidemment pas bénéficié, pour la perpétuation de sa légende de toute l’aura qu’aurait recueilli un film occidental du même niveau.
N’oublions pas que si le film retrace la période de la Grande Guerre patriotique, celle où l’Union soviétique de Stalingrad, après la Grande-Bretagne du Blitz a sauvé le monde de l’Horreur absolue, il a été tourné en pleine Guerre froide.
On a beaucoup vu en lui une sorte d’œuvre symbolique du dégel que tentait d’impulser Nikita Krouchtchev, parvenu difficilement au pouvoir après la mort de Staline ; notons combien le début du film avec les civils qui n’ont pas très envie de partir se battre, les petites magouilles afférentes à la mobilisation, la protestation individualiste de Véronika (Tatyana Samojlova) qui veut sauver son bonheur, combien ce début contraste avec la fin, toute de recueillement et d’émotion patriotique exaltée ; c’est tout à fait important, même si, d’emblée Boris (Aleksei Batalov), le fiancé de Véronika et son ami Stepan (Valentin Zoubkov) ont déjà fait le choix du Devoir. Mais il est vrai que, par rapport à la production stalinienne telle qu’on se l’imagine (et d’ailleurs Alexandre Nevski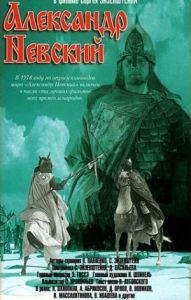 pourrait aussi être pris dans cette optique héroïciste et manichéenne), il y a une liberté de ton, une spontanéité qui surprennent, des critiques vives contre les parasites sociaux (Mark, le cousin planqué et veule – Alexandre Chvorine), la corruption des élites, la désorganisation des institutions (les hôpitaux bondés où on se refile les blessés).
pourrait aussi être pris dans cette optique héroïciste et manichéenne), il y a une liberté de ton, une spontanéité qui surprennent, des critiques vives contre les parasites sociaux (Mark, le cousin planqué et veule – Alexandre Chvorine), la corruption des élites, la désorganisation des institutions (les hôpitaux bondés où on se refile les blessés).
Mais – donc – 1957, c’est aussi un des moments d’intertension lors de la Guerre froide, un moment où la puissance de l’Union Soviétique paraît au sommet de la courbe : le 4 octobre 1957, le premier engin humain lancé dans l’espace, c’est le spoutnik, et l’U.R.S.S. semble, aux yeux de beaucoup, avoir pris une avance décisive sur les États-Unis, d’autant que les crises de l’année précédente (Hongrie en octobre, Suez en novembre) paraissent avoir plutôt tourné à son avantage : on peut donc entrouvrir le couvercle et laisser aux cinéastes un peu davantage la bride sur le cou.
Mais je ne suis pas sûr qu’il n’y ait eu pour le réalisateur, Mikhail Kalatozov , des pressions, une sorte de passage obligé et de caution donnée à l’autorité pour le filmage du retour des soldats et de la grande émotion patriotique que ressent tout un peuple, y compris Véronika : en 1957, la Guerre, son cortège de souffrance et de destructions, mais aussi le poids décisif pris par l’Armée Rouge dans la victoire alliée est trop présent, trop inscrit au cœur du peuple pour n’être qu’une figure de style…
, des pressions, une sorte de passage obligé et de caution donnée à l’autorité pour le filmage du retour des soldats et de la grande émotion patriotique que ressent tout un peuple, y compris Véronika : en 1957, la Guerre, son cortège de souffrance et de destructions, mais aussi le poids décisif pris par l’Armée Rouge dans la victoire alliée est trop présent, trop inscrit au cœur du peuple pour n’être qu’une figure de style…
Ces petites choses dites, communions dans l’extraordinaire beauté formelle de Quand passent les cigognes , dans la virtuosité des mouvements de caméra, virtuosité qui n’est jamais gratuite, qui marque plutôt, dans la légèreté des amoureux qui se poursuivent et s’embrassent, et se cherchent, et se défient tendrement au tout début du film l’insouciance d’avant le 22 juin 1941 ou, au contraire, dans la course désespérée et obsédante de Véronika montant quatre à quatre les escaliers de son immeuble bombardé, la terrible certitude de la mort des siens.
, dans la virtuosité des mouvements de caméra, virtuosité qui n’est jamais gratuite, qui marque plutôt, dans la légèreté des amoureux qui se poursuivent et s’embrassent, et se cherchent, et se défient tendrement au tout début du film l’insouciance d’avant le 22 juin 1941 ou, au contraire, dans la course désespérée et obsédante de Véronika montant quatre à quatre les escaliers de son immeuble bombardé, la terrible certitude de la mort des siens.
Tatyana Samojlova est une héroïne extraordinaire, qui porte dans sa beauté tour à tour joueuse et pathétique le poids d’un très grand film.