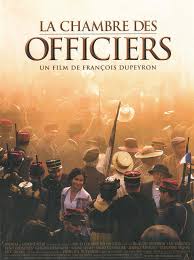 Après la vie.
Après la vie.
Du plus grand conflit de notre Histoire, de celui qui a laissé des cicatrices encore purulentes, un siècle après son achèvement, on ne parle plus tant que ça, finalement. De leur brève existence, les Étasuniens ont tiré des dizaines et des dizaines de beaux et grands films, sur la Guerre de Sécession ou sur l’extermination des Peaux-Rouges. Et nous bien peu, alors qu’il y aurait tant et tant à décrire… Qui se récriera et me citera une bonne centaine d’œuvres inspirées par le conflit majeur du siècle n’aura pas tort ; mais qu’est-ce que c’est que cette nomenclature au regard de celle consacrée à la Deuxième guerre, infiniment moins importante pour notre identité et notre être profond ?
 Il n’est donc pas mauvais qu’un film soit consacré aux séquelles de la Guerre et particulièrement à ces gueules cassées à qui on a achetait jadis des dixièmes de la Loterie nationale et dont mon enfance, qui n’osait pas trop manifester quelle horreur elles lui inspiraient lorsqu’elle en rencontrait une, n’était pas si éloignée. Un roman à succès de Marc Dugain a permis à François Dupeyron de réaliser un film plutôt intéressant à suivre, mais bien trop long et bien trop romanesque pour aller plus haut que la moyenne.
Il n’est donc pas mauvais qu’un film soit consacré aux séquelles de la Guerre et particulièrement à ces gueules cassées à qui on a achetait jadis des dixièmes de la Loterie nationale et dont mon enfance, qui n’osait pas trop manifester quelle horreur elles lui inspiraient lorsqu’elle en rencontrait une, n’était pas si éloignée. Un roman à succès de Marc Dugain a permis à François Dupeyron de réaliser un film plutôt intéressant à suivre, mais bien trop long et bien trop romanesque pour aller plus haut que la moyenne.

De la Guerre, habituellement, on ne retient que les héros (dans la geste exaltante qui a suivi 1918) et – désormais – les rebelles, les révoltés, les types qui ont mis la crosse en l’air ou qui, plus benoîtement, ont essayé de sortir de la fournaise (Un long dimanche de fiançailles, par exemple). La chambre des Officiers montre davantage ce qu’on a un peu honte de nommer les à-côtés de 14-18 : ce qui se passe pour les blessés ou pour les victimes ; voir Les fragments d’Antonin de Gabriel Le Bomin pour les uns, La vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier pour les autres.

La chambre des officiers est un récit romanesque bien conduit et assez prenant : un jeune officier, Adrien Fournier (Éric Caravaca) a été touché à la face, dès les premiers mois de la bataille, alors même que tout un avenir riant s’ouvrait à lui et qu’il venait de rencontrer, fortuitement, lors du départ d’un train vers le front, Clémence (Géraldine Pailhas) la compagne d’un mobilisé, avec qui il n’aurait pas dédaigné poursuivre le bavardage… Il est hospitalisé au Val-de-Grâce dans un service de grands blessés de la face. Il y rencontre un chirurgien (André Dussolier), passionné par l’expérimentation (on sait qu’il n’y a rien de mieux que les guerres pour faire progresser les techniques opératoires réparatrices) et Anaïs (Sabine Azéma), une infirmière d’une grande douceur qui le chérit comme son fils. Il y côtoie quelques camarades aux visages esquintés et il prendra au fur et à mesure des années qui passent un peu davantage de poids avec ces pauvres compagnons de géhenne.
 D’ailleurs tout ce qui se passe dans l’étroite chambrée où ces jeunes gens peu à peu comprennent que la vie qu’ils avaient rêvée s’est écroulée à cause d’un éclat d’obus ou de la chute d’un aéronef, est très bien. Se découvrir, hideux, monstrueux, inimaginables, s’entraider, se soutenir, s’accepter, essayer de croire que, la Guerre finie, les choses reviendront à peu près comme avant, lorsqu’autour de soi on voit bien les réticences, les retraits, les dégoûts de qui vous regarde et vous évalue. Et vous trouve incapable de réintégrer le monde des vivants, de ceux qui ont miraculeusement échappé aux déluges de sang.
D’ailleurs tout ce qui se passe dans l’étroite chambrée où ces jeunes gens peu à peu comprennent que la vie qu’ils avaient rêvée s’est écroulée à cause d’un éclat d’obus ou de la chute d’un aéronef, est très bien. Se découvrir, hideux, monstrueux, inimaginables, s’entraider, se soutenir, s’accepter, essayer de croire que, la Guerre finie, les choses reviendront à peu près comme avant, lorsqu’autour de soi on voit bien les réticences, les retraits, les dégoûts de qui vous regarde et vous évalue. Et vous trouve incapable de réintégrer le monde des vivants, de ceux qui ont miraculeusement échappé aux déluges de sang.

Tout ça ne serait pas mal, malgré les partis pris de François Dupeyron qui décentre trop souvent ses images et les revêt d’une lumière jaunâtre particulièrement agaçante, s’il ne croyait pas devoir achever son film par toute une suite romanesque extrêmement mal venue ; sans doute existe-t-elle dans le roman originel, mais ce n’est pas une raison. Voilà qu’au sortir de l’hôpital, où aurait dû se cantonner le film, on tombe dans le pathos et le melliflu. Que ce soit la malheureuse Marguerite (Isabelle Renauld) rejetée par sa piteuse famille parce qu’elle a une joue esquintée (comme c’est vraisemblable !) ou le courageux Adrien (Caravaca) qui, errant dans les rues de la ville, trouve miraculeusement une jeune fille qui clame qu’il n’est pas un monstre, on tombe dans la pire caramélerie…
Pourquoi faut-il, lorsqu’on filme tant d’horribles drames qu’il faille les terminer joliment ? Est-ce que la vie est comme ça ?