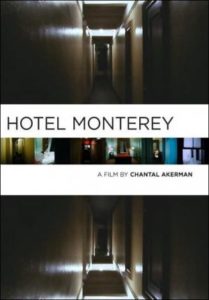Difficile d’aller jusqu’au bout a-t-on écrit de ce film. Si difficile que je n’y suis pas parvenu. Et pourtant, au rebours de mon goût affirmé pour la franchouillardise, les répliques de Michel Audiard, la rudesse de Jean Gabin et d’Alain Delon, les fantasmagories de Jacques Demy et quelques milliers d’autres plaisirs, il m’arrive de céder à d’honorables démons. D’aller voir chez des cinéastes réputés hermétiques, difficiles, rigoureux, austères, s’il y a un peu de miel à gratter. Je m’étais deux fois frotté à Chantal Akerman avec, dans l’ordre Jeanne Dielman, 23 quai du commerce (1975) et avec Les rendez-vous d’Anna (1978). Des films lents, arides, austères, glacés et quelquefois glaçants. Je n’avais pas eu beaucoup de plaisir de spectateur, mais j’avais écrit que je trouvais ce cinéma ni médiocre, ni inintéressant.
 Là, je suis allé plus loin. enfin… plus loin si je puis dire. Hôtel Monterey est le quatrième film de Chantal Akerman.Il dure un peu plus d’une heure. Il examine, scrute, explore du rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage un hôtel miteux pour pauvres new-yorkais. C’est réalisé avec une caméra qui fait du flou et du grumeleux une raison d’être ; ce n’est pas sonorisé. Vous m’avez bien compris : il n’y a ni dialogues, ni musiques, ni sons : un peu comme sur vos vieux film Super 8 que vous avez fait transposer sur DVD. C’est lourd à supporter, peut-on dire.
Là, je suis allé plus loin. enfin… plus loin si je puis dire. Hôtel Monterey est le quatrième film de Chantal Akerman.Il dure un peu plus d’une heure. Il examine, scrute, explore du rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage un hôtel miteux pour pauvres new-yorkais. C’est réalisé avec une caméra qui fait du flou et du grumeleux une raison d’être ; ce n’est pas sonorisé. Vous m’avez bien compris : il n’y a ni dialogues, ni musiques, ni sons : un peu comme sur vos vieux film Super 8 que vous avez fait transposer sur DVD. C’est lourd à supporter, peut-on dire.
 J’ai tenu une bonne demi-heure en me demandant avec effroi ce que je faisais là ; là à regarder des personnages anonymes qui ont l’air de se parler, des vieilles dames assemblées sur un canapé affaissé ; et deux d’entre elles s’en vont, n’en reste qu’une qui, au demeurant ressemble à Tsilla Chelton (mais ce n’est pas elle).
J’ai tenu une bonne demi-heure en me demandant avec effroi ce que je faisais là ; là à regarder des personnages anonymes qui ont l’air de se parler, des vieilles dames assemblées sur un canapé affaissé ; et deux d’entre elles s’en vont, n’en reste qu’une qui, au demeurant ressemble à Tsilla Chelton (mais ce n’est pas elle).
 On monte dans un ascenseur et on suit son ascension : jusque là, rien d’anormal, d’ailleurs. Puis on explore les niveaux, dans une lumière à la fois jaune et verte. Il paraît que l’hôtel filmé est un refuge pour personnes nécessiteuses. On admet bien volontiers qu’on ne voit pas là des gagnants de la mondialisation, mais de pauvres gens qui s’efforcent de survivre, sans être tout à fait dans la misère.
On monte dans un ascenseur et on suit son ascension : jusque là, rien d’anormal, d’ailleurs. Puis on explore les niveaux, dans une lumière à la fois jaune et verte. Il paraît que l’hôtel filmé est un refuge pour personnes nécessiteuses. On admet bien volontiers qu’on ne voit pas là des gagnants de la mondialisation, mais de pauvres gens qui s’efforcent de survivre, sans être tout à fait dans la misère.
 Je décroche. Je ne vois pas comment je peux continuer à passer du temps, du précieux temps, du temps précieux à regarder des ectoplasmes sans surface ni même silhouette. Et je m’interroge : je sais bien que la réalisatrice a dû filmer ça de façon tout à fait artisanale ; sans dialoguiste, sans preneur de son, sans compositeur, c’est une affaire entendue. Peut-être même sans directeur de la photographie (mais si ! il y en a eu une, Babette Mangolte : disons qu’elle ne s’est pas foulée) ; sans monteur (mais si : elle s’appelle Geneviève Luciani). C’est formidable, le cinéma : on peut tourner à la fois Cléopâtre (de Mankiewicz) et Hôtel Monterey de Chantal Akerman. Et on appelle tout ça des films.
Je décroche. Je ne vois pas comment je peux continuer à passer du temps, du précieux temps, du temps précieux à regarder des ectoplasmes sans surface ni même silhouette. Et je m’interroge : je sais bien que la réalisatrice a dû filmer ça de façon tout à fait artisanale ; sans dialoguiste, sans preneur de son, sans compositeur, c’est une affaire entendue. Peut-être même sans directeur de la photographie (mais si ! il y en a eu une, Babette Mangolte : disons qu’elle ne s’est pas foulée) ; sans monteur (mais si : elle s’appelle Geneviève Luciani). C’est formidable, le cinéma : on peut tourner à la fois Cléopâtre (de Mankiewicz) et Hôtel Monterey de Chantal Akerman. Et on appelle tout ça des films.
Drôle de tambouille, non ?