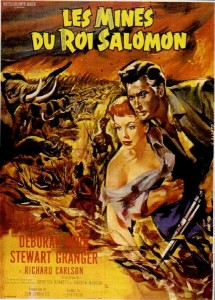
L’aventure africaine
Les enfants lecteurs des années Cinquante (je ne dis pas les enfants sages) avaient à leur disposition un Trésor dont tous connaissaient la clef, c’est-à-dire le nom : La bibliothèque verte. C’est dans ces livres solides, de format pratique et de qualité variée que beaucoup d’entre nous avons pris le goût de la lecture ; il est vrai que lorsque le livre original était trop long, ou que certains épisodes étaient un peu lestes (les Dumas , par exemple étaient de l’une et l’autre nature) l’éditeur élaguait sagement, pour ne pas lasser ou ne pas donner de mauvaises idées aux calmes bambins que nous étions.
, par exemple étaient de l’une et l’autre nature) l’éditeur élaguait sagement, pour ne pas lasser ou ne pas donner de mauvaises idées aux calmes bambins que nous étions.
 Il y avait plusieurs catégories d’ouvrages : les romans de Dumas
Il y avait plusieurs catégories d’ouvrages : les romans de Dumas ou de Jules Verne
ou de Jules Verne , les récits – de trappeurs et de Grand Nord – de Jack London
, les récits – de trappeurs et de Grand Nord – de Jack London ou de James Olivier Curwood, de plus classiques romans d’aventure ; il y avait aussi – qui restent en tout cas gravés dans ma mémoire – deux étranges histoires écrites par H. Rider Haggard
ou de James Olivier Curwood, de plus classiques romans d’aventure ; il y avait aussi – qui restent en tout cas gravés dans ma mémoire – deux étranges histoires écrites par H. Rider Haggard , dont l’une s’appelait – en Bibliothèque verte – La Cité sous la montagne (j’apprends qu’on en a tourné une adaptation, avec Ursula Andress
, dont l’une s’appelait – en Bibliothèque verte – La Cité sous la montagne (j’apprends qu’on en a tourné une adaptation, avec Ursula Andress , sous le titre La déesse du feu
, sous le titre La déesse du feu ) et l’autre Les mines du Roi Salomon
) et l’autre Les mines du Roi Salomon .
.
 Ce n’est que bien des années plus tard que j’ai su que ces deux perles fines faisaient l’une et l’autre partie de cycles : la première, le cycle de Elle-qui-doit-être-obéie, plus simplement She, sensuels récits de cette Reine éternelle qui, telle Antinéa, vit dans des grottes cachées, servie par un peuple à sa dévotion, qui se régénère perpétuellement grâce à une sorte de feu magique (en fait, par la consommation/consumation de jeunes aventuriers dont elle fait ses amants).
Ce n’est que bien des années plus tard que j’ai su que ces deux perles fines faisaient l’une et l’autre partie de cycles : la première, le cycle de Elle-qui-doit-être-obéie, plus simplement She, sensuels récits de cette Reine éternelle qui, telle Antinéa, vit dans des grottes cachées, servie par un peuple à sa dévotion, qui se régénère perpétuellement grâce à une sorte de feu magique (en fait, par la consommation/consumation de jeunes aventuriers dont elle fait ses amants).
La seconde perle, c’est donc le cycle d’Allan Quatermain, dont Les mines du Roi Salomon est sans doute le roman le plus célèbre.
est sans doute le roman le plus célèbre.
Ce long préambule idiotement nostalgique rédigé, passons donc à ce film de 1950, dont J. Lee Thompson a fait, d’ailleurs, un remake, en 1985, avec un certain Richard Chamberlain
a fait, d’ailleurs, un remake, en 1985, avec un certain Richard Chamberlain que je ne connais pas, et Sharon Stone
que je ne connais pas, et Sharon Stone que je croyais vouée aux pics à glace et non pas à l’Afrique éternelle.
que je croyais vouée aux pics à glace et non pas à l’Afrique éternelle.
 Je n’imagine pas une seconde que le VRAI film soit donc celui que deux réalisateurs ont mis en scène, aussi peu connus l’un que l’autre, Compton Bennett et Andrew Marton
Je n’imagine pas une seconde que le VRAI film soit donc celui que deux réalisateurs ont mis en scène, aussi peu connus l’un que l’autre, Compton Bennett et Andrew Marton ; mais lorsque dans une distribution, il y a la sublime Deborah Kerr
; mais lorsque dans une distribution, il y a la sublime Deborah Kerr et surtout Stewart Granger
et surtout Stewart Granger , le héros de Scaramouche
, le héros de Scaramouche , des Contrebandiers de Moonfleet
, des Contrebandiers de Moonfleet et du Prisonnier de Zenda
et du Prisonnier de Zenda , toute la magie du Technicolor et des grands espaces ne peut que laisser la portion congrue à toute resucée…
, toute la magie du Technicolor et des grands espaces ne peut que laisser la portion congrue à toute resucée…
 L’Afrique de 1895, celle des hauts plateaux, des savanes, des animaux sauvages du Tanganyka, de l’Ouganda, du Kenya, l’Afrique qui ne bougeait pas, qui soixante ans après, est (presque) encore la même, lorsque en 1962, Howard Hawks
L’Afrique de 1895, celle des hauts plateaux, des savanes, des animaux sauvages du Tanganyka, de l’Ouganda, du Kenya, l’Afrique qui ne bougeait pas, qui soixante ans après, est (presque) encore la même, lorsque en 1962, Howard Hawks tourne Hatari
tourne Hatari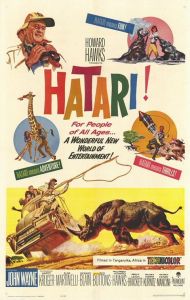 : mêmes paysages immenses, même vitalité de la nature, même étrangeté du rapport que nous avons, Occidentaux, noué avec la vieille Terre-Mère.
: mêmes paysages immenses, même vitalité de la nature, même étrangeté du rapport que nous avons, Occidentaux, noué avec la vieille Terre-Mère.
 Les mines du Roi Salomon
Les mines du Roi Salomon , dans ce qu’elles ont de meilleur est un très beau reportage sur ce monde qui n’existe plus pour les aventuriers, mais au pire pour les guerres et les massacres, au mieux pour les touristes… Confiné dans le format standard de l’heure et demie, les réalisateurs n’ont pas développé, ou pas assez certains épisodes angoissants, comme l’enfermement de nos explorateurs dans les entrailles de la montagne, à côté de milliers de diamants bruts ; mais pour leur fraîcheur, leur beauté formelle, le talent de leurs interprètes, comme on est content d’avoir retrouvé le parfum d’enfance de ce Monde si loin, si proche…
, dans ce qu’elles ont de meilleur est un très beau reportage sur ce monde qui n’existe plus pour les aventuriers, mais au pire pour les guerres et les massacres, au mieux pour les touristes… Confiné dans le format standard de l’heure et demie, les réalisateurs n’ont pas développé, ou pas assez certains épisodes angoissants, comme l’enfermement de nos explorateurs dans les entrailles de la montagne, à côté de milliers de diamants bruts ; mais pour leur fraîcheur, leur beauté formelle, le talent de leurs interprètes, comme on est content d’avoir retrouvé le parfum d’enfance de ce Monde si loin, si proche…