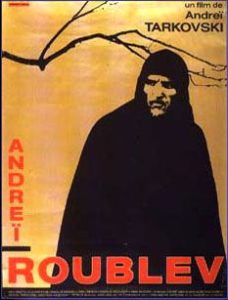 Aussi beau qu’ennuyeux.
Aussi beau qu’ennuyeux.
Il y a des jours où l’âme slave, qui m’est pourtant si chère, est un peu trop compliquée pour moi et où je ne comprends plus ses foucades, ses subtilités et ses incandescences. Cela m’est arrivé à la lecture des Frères Karamazov ; et à nouveau hier, en regardant Andreï Roublev,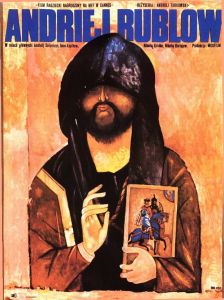 que j’avais beaucoup apprécié il y a quelques années, et qui m’a souvent exaspéré, à tout le moins profondément ennuyé. Il est bien ennuyeux, de toute façon, de prendre conscience qu’on n’a pas raison d’être un peu abandonné en route.
que j’avais beaucoup apprécié il y a quelques années, et qui m’a souvent exaspéré, à tout le moins profondément ennuyé. Il est bien ennuyeux, de toute façon, de prendre conscience qu’on n’a pas raison d’être un peu abandonné en route.

C’est entendu et ce n’est pas contestable : le film est un admirable recueil d’images et la façon de filmer de Andrei Tarkovsky, sa sensibilité extrême, son sens de la désolation, qui s’exprime à tout instant par des choses très simples (la pluie qui tombe en averse drue, les feuilles mortes qui brûlent, la terre imbibée d’eau, le crépi usé des murs) sont ceux d’un artiste profond.
sa sensibilité extrême, son sens de la désolation, qui s’exprime à tout instant par des choses très simples (la pluie qui tombe en averse drue, les feuilles mortes qui brûlent, la terre imbibée d’eau, le crépi usé des murs) sont ceux d’un artiste profond.
Mais la lenteur du récit, ses ellipses étonnantes et agaçantes, sa division en séquences hiératiques apparaissent artificielles et même un peu hautaines. Je tiens pour rien la petite connaissance de l’histoire de la Russie qu’il faut avoir pour se colleter à la période troublée du début du 15ème siècle ; après tout, Wikipédia n’est pas fait pour les chiens et si l’on éprouve de l’intérêt pour un peuple et une civilisation, le moins qu’on puisse lui donner est d’aller jeter un œil attentif sur son passé, ce qui en fait l’esprit, l’identité et la légende. Mais je ne suis pas certain qu’on puisse passer au dessus de tout ce qui fait l’âme d’un peuple sans en connaître la langue, la spiritualité, les traditions, sans participer complètement de son génie propre. Vieux débat et vieilles querelles que j’ai eus ici et là à propos d’autres cinémas.
 En vingt lignes, j’ai écrit deux fois le mot âme ; ce n’est pas volontaire, mais ce n’est certainement pas par hasard que je l’ai fait : il y a dans Andreï Roublev
En vingt lignes, j’ai écrit deux fois le mot âme ; ce n’est pas volontaire, mais ce n’est certainement pas par hasard que je l’ai fait : il y a dans Andreï Roublev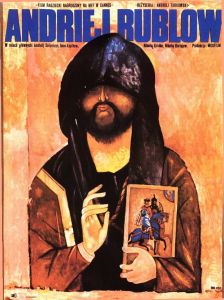 ces exaltations, chagrins, furies, violences, cruautés, réconciliations, terreurs, mélancolies qu’on prête, à tort ou à raison, au caractère slave, à cette immense Russie, dont la capacité de souffrir, d’endurer, d’absorber le Mal, mais aussi de lui résister et, finalement de le vaincre sont une des constantes. Aussi la facilité de passer en un instant du rire aux larmes, du grotesque au tragique, du dérisoire au pompeux, du misérable à l’opulent que nous ne connaissons pas en Occident.
ces exaltations, chagrins, furies, violences, cruautés, réconciliations, terreurs, mélancolies qu’on prête, à tort ou à raison, au caractère slave, à cette immense Russie, dont la capacité de souffrir, d’endurer, d’absorber le Mal, mais aussi de lui résister et, finalement de le vaincre sont une des constantes. Aussi la facilité de passer en un instant du rire aux larmes, du grotesque au tragique, du dérisoire au pompeux, du misérable à l’opulent que nous ne connaissons pas en Occident.
 Mais rien de plus difficile à saisir qu’une âme, tous les confesseurs vous le diront. C’est un chemin escarpé, austère, qui demande un effort considérable pour le moindre cheminement. Tarkovsky
Mais rien de plus difficile à saisir qu’une âme, tous les confesseurs vous le diront. C’est un chemin escarpé, austère, qui demande un effort considérable pour le moindre cheminement. Tarkovsky se place un peu au bord du chemin de son personnage, moine et peintre d’icônes, dans les temps incertains des invasions tartares, de la dévastation des villes et des luttes fratricides. Il a écrit,en présentant Roublev pour Les Cahiers du cinéma ce portrait que je souhaiterais qu’on me décrypte : L’histoire de la vie de Roublev est l’histoire d’un concept enseigné et imposé, qui se brûle dans l’atmosphère de la réalité vivante, pour renaître de ses cendres comme une vérité nouvelle à peine découverte. Lisant ceci, je crains de ne pas être plus avancé.
se place un peu au bord du chemin de son personnage, moine et peintre d’icônes, dans les temps incertains des invasions tartares, de la dévastation des villes et des luttes fratricides. Il a écrit,en présentant Roublev pour Les Cahiers du cinéma ce portrait que je souhaiterais qu’on me décrypte : L’histoire de la vie de Roublev est l’histoire d’un concept enseigné et imposé, qui se brûle dans l’atmosphère de la réalité vivante, pour renaître de ses cendres comme une vérité nouvelle à peine découverte. Lisant ceci, je crains de ne pas être plus avancé.
 Naturellement ma note, exactement médiane, est absolument arbitraire : elle serait beaucoup plus faible si elle ne s’établissait que sur le récit, beaucoup plus forte si elle ne considérait que des séquences d’une brûlante envolée, la mise à sac de la ville de Vladimir, par exemple, la coulée de la cloche de bronze, qui marque la renaissance d’un village, ou la fête païenne orgiaque (qui m’a fait songer, tout à la fois, et sans vraie cohérence, à The wicker man
Naturellement ma note, exactement médiane, est absolument arbitraire : elle serait beaucoup plus faible si elle ne s’établissait que sur le récit, beaucoup plus forte si elle ne considérait que des séquences d’une brûlante envolée, la mise à sac de la ville de Vladimir, par exemple, la coulée de la cloche de bronze, qui marque la renaissance d’un village, ou la fête païenne orgiaque (qui m’a fait songer, tout à la fois, et sans vraie cohérence, à The wicker man et au Temps des gitans).
et au Temps des gitans).
Bref, il faudra que je revoie Andreï Roublev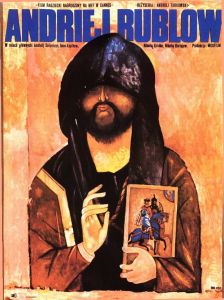 dans une dizaine d’années. Si Dieu, d’ici là, me prête vie…
dans une dizaine d’années. Si Dieu, d’ici là, me prête vie…