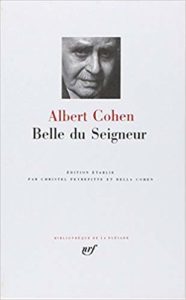 Promenade avec l’amour et la mort.
Promenade avec l’amour et la mort.
Qu’est-ce que c’est que ce livre qui a fasciné, émerveillé, stupéfié des générations, saisies par l’histoire éclatante de Solal et d’Ariane, goûtée jusqu’à l’amertume et la désolation ? Qu’est-ce que c’est que ce livre-phare de la Littérature française ? Ce livre-continent qu’on peut ne pas cesser d’explorer et qui, comme tous les continents, va de plaines en montagnes, de rivières en précipices, de volcans en marécages ?
A-t-on l’œil grave et le jugement pincé, l’âme sèche et l’esprit étroit, on va trouver qu’il est terriblement mal composé, territoire baroque, excessif, contrefait. Y interviennent, ou y passent, ou y surgissent sans prévenir, de chapitre en chapitre, des archipels à peine reliables les uns aux autres. Mesquineries pathétiques des trois Deume, bouffonneries éclatantes des cinq Valeureux mais aussi papotages intérieurs de la servante Mariette, spiritualité du pasteur Agrippa d’Auble, l’oncle d’Ariane et aussi désespérance d’Isolde, l’ancienne amante de Solal, qui se suicide à Marseille.
Et naturellement bien sûr les deux amants magnifiques.
Et tous ces chapitres se succèdent, s’escaladent, s’enchevêtrent ; tous les personnages n’ont pas la même importance, mais tous ont une telle personnalité, une telle caractérisation, qu’on se les rappelle.
Cette opulence barbare emploie tant de registres littéraires – récit, dialogue, monologue intérieur, incantation lyrique – qu’on peut en être un peu désarçonné. La première fois qu’on lit Belle du Seigneur (Dieu sait si c’est une œuvre qui justifie qu’on la lise et relise), on court, on chevauche, on cavalcade, on s’impatiente tant on est pressé de connaître la suite… et en même temps on est navré à chaque page tournée qui va vers la fin de plus en plus proche du plaisir de lire.
On respire pourtant ici et là les graines d’amertume semées par Albert Cohen, les graines qu’il fera germer jusqu’à ce qu’elles explosent dans les dernières parties. Seulement dès qu’on veut en savoir un peu davantage, on va aller se plonger dans la grande navigation, dans l’archipel de Cohen.
Parce que c’est naturellement la totalité de l’histoire de Solal qu’il faut lire. Une histoire qui commence en 1930, avec le roman qui porte son seul nom, qui se poursuit avec Mangeclous en 1938, avec, donc, Belle du Seigneur en 1968 et qui se conclut avec Les Valeureux en 1969.
C’est dans cet ordre que la collection Quarto de Gallimard la présente. Et pourtant ce n’est pas tout à fait satisfaisant, notamment parce que Solal est une sorte d’esquisse, de brouillon (de la même façon qu’Angelo est le brouillon du Hussard sur le toit) ; et Mangeclous, quoique publié 30 ans avant Belle du Seigneur précède immédiatement l’œuvre majeure et s’achève à la minute même où Solal entre dans la chambre d’Ariane, les dents noircies, vêtu de son caftan crasseux. Et puis que Les Valeureux sont, en fait, des pages qui auraient dû figurer dans Belle du Seigneur et qui en ont été retirées à la demande de l’éditeur, effrayé par la dimension du livre (qui compte néanmoins 1152 pages en Pléiade). Comme tous les manuscrits d’Albert Cohen ont été détruits, à son injonction, il n’est pas possible aujourd’hui de réincorporer Les Valeureux à Belle et de saisir vraiment les intentions initiales de l’auteur.
En fait, si l’on veut bien quitter l’anecdote éditoriale, il faut aller un peu plus loin, à l’essence même des choses, à la conviction de Cohen que la passion amoureuse est vouée à disparaître et même à pourrir si elle ne se transforme pas. Qu’on écoute bien ce qu’il dit dans un entretien dont je n’ai pas conservé la référence exacte :
« L’attrait sexuel est une chose qui existe. C’est, en quelque sorte, le commencement de quelque chose qui doit changer ensuite. La beauté et la grandeur c’est que cet attrait sexuel fasse assez rapidement place à quelque chose de beaucoup plus important, au véritable amour – pas à la passion, que je déteste ! Seulement, ô merveille, ô miracle ! Une fois que deux êtres ont été attirés par la chair, s’ils sont dignes de cela vient alors le véritable amour. Et cet amour-là, voyez-vous, est très proche de l’amour maternel, de l’amour filial, parce qu’à ce moment-là, le miracle qui peut se produire, c’est que celle qui a été au début attirée par la passion et par les charmes et les gloire de la sexualité, cette épouse devienne à la fois la mère et la fille, et que lui devienne à la fois le père et le fils. Et plus que cela, qu’elle devienne aussi la sœur et le frère et l’ami ».
Comment ne pas faire le rapport avec le bouleversant Livre de ma mère paru en 1954 où Cohen n’a pas de mal à montrer que l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant, indépendant de la beauté, de l’intelligence, de la séduction de l’enfant, est, à ses yeux beaucoup plus véridique que l’amour-passion sujet à la routine, à la lassitude, à l’exaspération ? Ariane et Solal cloîtrés dans la belle maison d’Agay et se devenant peu à peu mutuellement insupportables (l’anaphore Leur pauvre vie) vont naturellement vers le suicide, seule solution logique de leur échec, de leur déchéance physique et morale. Il y a longtemps que Blaise Pascal a écrit que Qui veut faire l’ange fait la bête.
Il m’est arrivé de rencontrer des lecteurs (et peut-être surtout des lectrices) qui jugeaient que Belle du Seigneur est une magnifique histoire d’amour… Comme c’est bizarre ! Et quand je leur citais cette phrase issue de Mangeclous et qui est le maître-mot de la pensée de Cohen, ils paraissaient ne pas comprendre…
« Le vrai amour, ce n’est pas de vivre avec une femme parce qu’on l’aime, mais de l’aimer parce qu’on vit avec elle« .
C’est pourtant clair, non ?