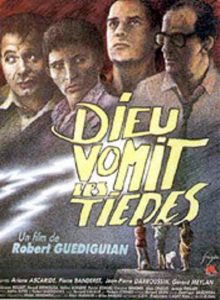 Ça commence à s’arranger.
Ça commence à s’arranger.
Ah oui, ça s’arrange assez bien, ça revient au niveau de l’intéressant premier film, Dernier été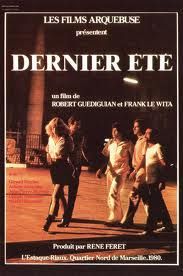 , et c’est même un peu davantage. Ça ne manque pas de maladresses, de balourdises, de tics innocents, de quelques grossièretés de réalisation, mais enfin les personnages sont bien en place, ils ont un comportement cohérent, ils ont la place dans l’histoire.
, et c’est même un peu davantage. Ça ne manque pas de maladresses, de balourdises, de tics innocents, de quelques grossièretés de réalisation, mais enfin les personnages sont bien en place, ils ont un comportement cohérent, ils ont la place dans l’histoire.
Guédiguian poursuit son chemin nostalgique de militant communiste désenchanté… Comment ne pas le comprendre, comment ne pas comprendre tous ces braves types intelligents et exaltés qui ont subi l’écrasement de leurs idéaux dans la révélation des crimes de Staline, dans l’écrasement de Budapest, de Prague, dans la folie sanglante des Khmers rouges, dans les illusions dissipées du retour à la rigueur et le désespoir de ne pouvoir changer la vie et de se retrouver à gérer la réalité en voyant, en plus, triompher, la panse grasse du libéralisme ?
poursuit son chemin nostalgique de militant communiste désenchanté… Comment ne pas le comprendre, comment ne pas comprendre tous ces braves types intelligents et exaltés qui ont subi l’écrasement de leurs idéaux dans la révélation des crimes de Staline, dans l’écrasement de Budapest, de Prague, dans la folie sanglante des Khmers rouges, dans les illusions dissipées du retour à la rigueur et le désespoir de ne pouvoir changer la vie et de se retrouver à gérer la réalité en voyant, en plus, triompher, la panse grasse du libéralisme ?
 Dieu vomit les tièdes
Dieu vomit les tièdes – titre tiré d’un verset de L’Apocalypse – se passe en 1989, aux moments consensuels du Bicentenaire de la Révolution française ; 89, moment de concorde et d’espérance, avant 92, début d’une utopie majuscule. Les quatre personnages principaux se sont juré vingt ans auparavant, lorsqu’ils étaient de clairs et révoltés enfants de pauvres, qu’ils se battraient pour que vienne le jour où tout le monde sera riche sans être capitaliste. Depuis lors Cochise (Jean-Pierre Darroussin
– titre tiré d’un verset de L’Apocalypse – se passe en 1989, aux moments consensuels du Bicentenaire de la Révolution française ; 89, moment de concorde et d’espérance, avant 92, début d’une utopie majuscule. Les quatre personnages principaux se sont juré vingt ans auparavant, lorsqu’ils étaient de clairs et révoltés enfants de pauvres, qu’ils se battraient pour que vienne le jour où tout le monde sera riche sans être capitaliste. Depuis lors Cochise (Jean-Pierre Darroussin ) est devenu un romancier à succès, Quatre œils (Pierre Banderet) est un mauvais journaliste, Tirelire Ariane Ascaride
) est devenu un romancier à succès, Quatre œils (Pierre Banderet) est un mauvais journaliste, Tirelire Ariane Ascaride , serveuse de bistro, couche avec à peu près tout le monde et Frisé (Gérard Meylan), qui est seul resté fidèle à ses rêves de gosse, survit en zonant et en peignant interminablement le pont du canal de Caronte, qui relie l’étang de Berre et la Méditerranée.
, serveuse de bistro, couche avec à peu près tout le monde et Frisé (Gérard Meylan), qui est seul resté fidèle à ses rêves de gosse, survit en zonant et en peignant interminablement le pont du canal de Caronte, qui relie l’étang de Berre et la Méditerranée.
 Ce pont tournant, nous le connaissons bien, depuis Toni
Ce pont tournant, nous le connaissons bien, depuis Toni de Jean Renoir
de Jean Renoir , où il figurait dans le décor. Là, il est un peu davantage et son omniprésence tout autant que sa machinerie compliquée en font presque un protagoniste. Il faut dire que le film ne se passe pas à Marseille, à L’Estaque, pour une fois, mais à Martigues, à qui les destructions du dernier siècle n’ont pas tout à fait enlevé le charme de sa situation de Venise provençale éparpillée dans les trois quartiers de Jonquières, l’Île et Ferrières, séparés par de multiples canaux et irisée d’une lumière particulière qui a beaucoup attiré les peintres. En tout cas, si Guédiguian
, où il figurait dans le décor. Là, il est un peu davantage et son omniprésence tout autant que sa machinerie compliquée en font presque un protagoniste. Il faut dire que le film ne se passe pas à Marseille, à L’Estaque, pour une fois, mais à Martigues, à qui les destructions du dernier siècle n’ont pas tout à fait enlevé le charme de sa situation de Venise provençale éparpillée dans les trois quartiers de Jonquières, l’Île et Ferrières, séparés par de multiples canaux et irisée d’une lumière particulière qui a beaucoup attiré les peintres. En tout cas, si Guédiguian ne filme pas la même ville, il met en valeur aussi bien que d’habitude le sel de la mer, les platanes qui donnent une ombre si épaisse et si tendre, le vent qui caresse les soirées tièdes…
ne filme pas la même ville, il met en valeur aussi bien que d’habitude le sel de la mer, les platanes qui donnent une ombre si épaisse et si tendre, le vent qui caresse les soirées tièdes…
 Les films de retrouvailles sont souvent pleins de charme, puisque nous nous y retrouvons tous, plus ou moins ; celui-ci serait excellent, dans la banalité consentie des jours si, scorie habituelle, ne venait se greffer un (tout petit) mystère criminalo-politique. C’est que, dans le désespoir du renoncement à la pureté de la jeunesse, on peut bêtement choisir la révolte et la folie ; comme le Bruno Leroux du Cavale
Les films de retrouvailles sont souvent pleins de charme, puisque nous nous y retrouvons tous, plus ou moins ; celui-ci serait excellent, dans la banalité consentie des jours si, scorie habituelle, ne venait se greffer un (tout petit) mystère criminalo-politique. C’est que, dans le désespoir du renoncement à la pureté de la jeunesse, on peut bêtement choisir la révolte et la folie ; comme le Bruno Leroux du Cavale de Belvaux
de Belvaux , mais de manière plus fruste, Frisé (Gérard Meylan
, mais de manière plus fruste, Frisé (Gérard Meylan ) ne peut pas supporter le compromis, et veut débarrasser le monde de sa vermine, celle qui grouille, qui est partout, qu’on va éliminer.
) ne peut pas supporter le compromis, et veut débarrasser le monde de sa vermine, celle qui grouille, qui est partout, qu’on va éliminer.
Devant l’impasse, Guédiguian recule. Et le dernier plan des deux amis détruits, devant le canal impassible, est bien beau.
recule. Et le dernier plan des deux amis détruits, devant le canal impassible, est bien beau.