 Simenon, malgré tout.
Simenon, malgré tout.
Il fut un temps où tout réalisateur qui se plongeait dans l’immense jungle de l’œuvre de Georges Simenon pouvait y trouver un sujet, une orientation, une atmosphère et, même en les maltraitant, parvenir à faire vivre un monde, tant la puissance d’évocation du romancier est intense. Sans doute toutes les adaptations ne sont-elles pas de qualité, notamment celles des Maigret, parce que les metteurs en scène ont généralement privilégié la résolution d’une énigme policière – rarement primordiale – à ce qui importait vraiment à l’écrivain : la recréation d’un univers.
pouvait y trouver un sujet, une orientation, une atmosphère et, même en les maltraitant, parvenir à faire vivre un monde, tant la puissance d’évocation du romancier est intense. Sans doute toutes les adaptations ne sont-elles pas de qualité, notamment celles des Maigret, parce que les metteurs en scène ont généralement privilégié la résolution d’une énigme policière – rarement primordiale – à ce qui importait vraiment à l’écrivain : la recréation d’un univers.
 Mais il y a tant de substance dans les romans de Simenon,
Mais il y a tant de substance dans les romans de Simenon, tant de talent brut et immédiat, qu’on peut le plus souvent trouver son content dans ces histoires simples qui vous prennent dès les premiers paragraphes et ne vous lâchent plus. En tout cas, c’était ce qui ce faisait encore naguère et ce qui ne se fait plus beaucoup. La liste des adaptations publiée dans le site très exhaustif Tout Simenon, et que l’on trouve développée dans http://www.toutsimenon.com/adaptations.h(..) est aussi exiguë, après 2000, qu’elle était dense auparavant ; on dirait que les cinéastes d’aujourd’hui considèrent que des récits ancrés dans le monde d’hier ne peuvent plus intéresser un public féru d’images numériques et de sujets de société.
tant de talent brut et immédiat, qu’on peut le plus souvent trouver son content dans ces histoires simples qui vous prennent dès les premiers paragraphes et ne vous lâchent plus. En tout cas, c’était ce qui ce faisait encore naguère et ce qui ne se fait plus beaucoup. La liste des adaptations publiée dans le site très exhaustif Tout Simenon, et que l’on trouve développée dans http://www.toutsimenon.com/adaptations.h(..) est aussi exiguë, après 2000, qu’elle était dense auparavant ; on dirait que les cinéastes d’aujourd’hui considèrent que des récits ancrés dans le monde d’hier ne peuvent plus intéresser un public féru d’images numériques et de sujets de société.
 Ils ont peut-être raison, mais c’est bien dommage. Parce que, même si on les réécrit, les travestit, les modifie, les histoires contées par Simenon
Ils ont peut-être raison, mais c’est bien dommage. Parce que, même si on les réécrit, les travestit, les modifie, les histoires contées par Simenon ont une telle force intrinsèque qu’elles parviennent à reprendre le dessus. La veuve Couderc
ont une telle force intrinsèque qu’elles parviennent à reprendre le dessus. La veuve Couderc est un assez bon exemple de ce point de vue. Le film est notablement différent du roman ; Pierre Granier-Deferre
est un assez bon exemple de ce point de vue. Le film est notablement différent du roman ; Pierre Granier-Deferre et son scénariste, Pascal Jardin, sont allés jusqu’à changer – sans nécessité objective – le nom du principal protagoniste (Alain Delon)
et son scénariste, Pascal Jardin, sont allés jusqu’à changer – sans nécessité objective – le nom du principal protagoniste (Alain Delon) , Jean Passerat-Monneyeur en Jean Lavigne, mais aussi à en faire un évadé de prison, et non un prisonnier libéré après l’exécution de sa peine et, de ce fait, dans une démarche plus romanesque, de le faire abattre par un rassemblement considérable de gendarmes mobiles alors que, dans le roman, exaspéré par la jalousie de Tati Couderc (Simone Signoret)
, Jean Passerat-Monneyeur en Jean Lavigne, mais aussi à en faire un évadé de prison, et non un prisonnier libéré après l’exécution de sa peine et, de ce fait, dans une démarche plus romanesque, de le faire abattre par un rassemblement considérable de gendarmes mobiles alors que, dans le roman, exaspéré par la jalousie de Tati Couderc (Simone Signoret) qui ne supporte pas qu’il lui préfère Félicie (Ottavia Piccolo)
qui ne supporte pas qu’il lui préfère Félicie (Ottavia Piccolo) il la tue, plus simplement.
il la tue, plus simplement.
Granier-Deferre et Jardin, dans la mode de l’époque du tournage (1971) ont, de surcroît, ajouté quelques implantations politiques qui paraissent aujourd’hui assez grotesques ; ainsi l’éclusier Désiré (Bobby Lapointe), beau-frère haineux de Tati, lisant L’Action française (beaucoup trop intellectuel pour lui ; tant à faire, on aurait pu lui mettre dans les mains L’Ami du peuple, un vrai journal populiste) ; ainsi l’inscription antisémite sur l’église du bourg, concevable avant la Grande guerre, mais pas en 1934 en France ; ainsi l’usine occupée par des grévistes (on n’est pas en 1936) ; ainsi l’irruption des Dispos (le service d’ordre des Croix-de-feu) prétendant venir prêter main forte à la police pour l’arrestation de Jean. Tout cela irrite un peu.
et Jardin, dans la mode de l’époque du tournage (1971) ont, de surcroît, ajouté quelques implantations politiques qui paraissent aujourd’hui assez grotesques ; ainsi l’éclusier Désiré (Bobby Lapointe), beau-frère haineux de Tati, lisant L’Action française (beaucoup trop intellectuel pour lui ; tant à faire, on aurait pu lui mettre dans les mains L’Ami du peuple, un vrai journal populiste) ; ainsi l’inscription antisémite sur l’église du bourg, concevable avant la Grande guerre, mais pas en 1934 en France ; ainsi l’usine occupée par des grévistes (on n’est pas en 1936) ; ainsi l’irruption des Dispos (le service d’ordre des Croix-de-feu) prétendant venir prêter main forte à la police pour l’arrestation de Jean. Tout cela irrite un peu.
 Et malgré tout cela, La veuve Couderc
Et malgré tout cela, La veuve Couderc est un film formidable, au niveau du Chat,
est un film formidable, au niveau du Chat, œuvre majeure de Pierre Granier-Deferre,
œuvre majeure de Pierre Granier-Deferre, qui fut bien mieux qu’un simple artisan du cinéma comme il affectait de se considérer. Un film formidable et qui ne l’est pas seulement par le talent mis à filmer l’eau paisible du canal de la Marne à la Saône et le pont-levis de Cheuge, par la férocité de l’observation de l’aversion campagnarde pour la servante qui est parvenue à se faire épouser et des haines paysannes recuites par les incestes et les attentes d’héritage, par la musique de Philippe Sarde.
qui fut bien mieux qu’un simple artisan du cinéma comme il affectait de se considérer. Un film formidable et qui ne l’est pas seulement par le talent mis à filmer l’eau paisible du canal de la Marne à la Saône et le pont-levis de Cheuge, par la férocité de l’observation de l’aversion campagnarde pour la servante qui est parvenue à se faire épouser et des haines paysannes recuites par les incestes et les attentes d’héritage, par la musique de Philippe Sarde.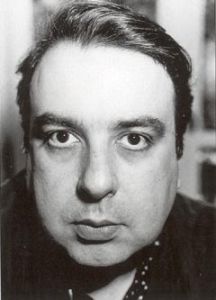
Il l’est aussi, évidemment,par l’improbable et parfaite osmose entre Alain Delon et Simone Signoret,
et Simone Signoret, par le choix d’Ottavia Piccolo,
par le choix d’Ottavia Piccolo, petit animal ravissant, sensuel et stupide.
petit animal ravissant, sensuel et stupide.
 Et puis le vieux Père Couderc, qui a violé Tati quand elle n’avait que quatorze ans et qui vient encore lui mendier certaines nuits, rudoyé par celle qui est devenue la maîtresse de la ferme, maltraité par sa fille (Monique Chaumette)
Et puis le vieux Père Couderc, qui a violé Tati quand elle n’avait que quatorze ans et qui vient encore lui mendier certaines nuits, rudoyé par celle qui est devenue la maîtresse de la ferme, maltraité par sa fille (Monique Chaumette) et son gendre (Bobby Lapointe), à la fois pitoyable et répugnant, douloureux, buté, amer. C’était l’avant-dernier rôle de Jean Tissier,
et son gendre (Bobby Lapointe), à la fois pitoyable et répugnant, douloureux, buté, amer. C’était l’avant-dernier rôle de Jean Tissier, et peut-être, de la longue suite de ses tournages, le meilleur, avec celui de l’affreux Lalah-Poor de L’assassin habite au 21.
et peut-être, de la longue suite de ses tournages, le meilleur, avec celui de l’affreux Lalah-Poor de L’assassin habite au 21. Jean Tissier
Jean Tissier a fini sa vie dans la dépression, dans la déchéance physique et dans la misère. Combien cet apparent plaisantin de tant et tant de nanards savait aussi porter la tristesse…
a fini sa vie dans la dépression, dans la déchéance physique et dans la misère. Combien cet apparent plaisantin de tant et tant de nanards savait aussi porter la tristesse…
Est-ce que ce n’est pas une ironie narquoise du sort que celui qu’on avait surnommé Le nonchalant qui passe, en allusion à la chanson qui fit un triomphe en 1933 (et dont avait sottement baptisé L’Atalante de Jean Vigo)
de Jean Vigo) ait tourné son dernier rôle auprès d’un canal ?
ait tourné son dernier rôle auprès d’un canal ?