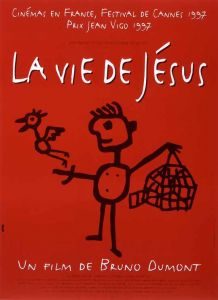Né lui-même à Bailleul, entre Lille et Dunkerque, Bruno Dumont ne cesse de filmer son Nord. Sans tricher ni tromper le spectateur : on n’est pas, avec lui, dans l’immonde bouffonnerie dégradante de Bienvenue chez les ch’tis. Les images de Dumont ne dissimulent ni le ciel gris, ni la pesanteur banale de la ville de briques sales, ni la laideur des campagnes pelées à lourds chemins boueux, ni l’ennui incroyable des rues de province. Et elles n’ont pas beaucoup de complaisance pour les corps et les visages des acteurs, non professionnels, qui ont vraiment des tronches maladives, graisseuses, marquées par la fatalité de l’alcoolisme héréditaire.
 Exception toutefois : lumineuse Marie (Marjorie Cottreel) que tous désirent mais qui couche seulement avec Freddy (David Douche) dont nous suivons la pauvre existence entre automne maussade et été pourri. Autre exception à cette misère physique : Kader (Kader Chaatouf), jeune Arabe du coin, comme tel détesté par Freddy et sa bande de glandeurs à mobylettes trafiquées sonores et puantes ; Kader n’est sûrement pas beaucoup plus intéressant que les autres, mais comme il est seul, il est au moins dépouillé de la connerie intrinsèque et fondamentale des bandes de vieux adolescents.
Exception toutefois : lumineuse Marie (Marjorie Cottreel) que tous désirent mais qui couche seulement avec Freddy (David Douche) dont nous suivons la pauvre existence entre automne maussade et été pourri. Autre exception à cette misère physique : Kader (Kader Chaatouf), jeune Arabe du coin, comme tel détesté par Freddy et sa bande de glandeurs à mobylettes trafiquées sonores et puantes ; Kader n’est sûrement pas beaucoup plus intéressant que les autres, mais comme il est seul, il est au moins dépouillé de la connerie intrinsèque et fondamentale des bandes de vieux adolescents.
 Reprenons par le commencement. Freddy vit avec sa mère, veuve, qui tient un tout petit bistrot, Au petit casino dans une longue rue de Bailleul, ennuyeuse comme un jour sans pain. Buté, fermé, taciturne, paresseux, Freddy souffre en plus d’épilepsie. Sa mère, Yvette, une brave femme de mère (Geneviève Cottreel) tente bien de secouer l’apathie de son gamin, mais n’y peut pas grand chose ; et elle semble être bien contente qu’il couche avec Marie, caissière au supermarché, qui, en plus d’être jolie, paraît sérieuse et paisible.
Reprenons par le commencement. Freddy vit avec sa mère, veuve, qui tient un tout petit bistrot, Au petit casino dans une longue rue de Bailleul, ennuyeuse comme un jour sans pain. Buté, fermé, taciturne, paresseux, Freddy souffre en plus d’épilepsie. Sa mère, Yvette, une brave femme de mère (Geneviève Cottreel) tente bien de secouer l’apathie de son gamin, mais n’y peut pas grand chose ; et elle semble être bien contente qu’il couche avec Marie, caissière au supermarché, qui, en plus d’être jolie, paraît sérieuse et paisible.
 Que font tous ces désœuvrés de leur journée, à part bricoler leurs bécanes et de vieilles autos ? Ils attendent que quelque chose se passe, font pétarader leurs engins, font partie de l’harmonie municipale et – Freddy en tout cas – élèvent des pinsons en vue de concours de chants très sérieux et très incongrus (jadis on aveuglait les oiseaux de façon qu’ils chantent plus et mieux). Bruno Dumont filme avec beaucoup de force la lenteur des jours médiocres et les étreintes sans romantisme de Freddy et de Marie. Sans voyeurisme, mais avec la crudité nécessaire au sujet.
Que font tous ces désœuvrés de leur journée, à part bricoler leurs bécanes et de vieilles autos ? Ils attendent que quelque chose se passe, font pétarader leurs engins, font partie de l’harmonie municipale et – Freddy en tout cas – élèvent des pinsons en vue de concours de chants très sérieux et très incongrus (jadis on aveuglait les oiseaux de façon qu’ils chantent plus et mieux). Bruno Dumont filme avec beaucoup de force la lenteur des jours médiocres et les étreintes sans romantisme de Freddy et de Marie. Sans voyeurisme, mais avec la crudité nécessaire au sujet.
 On ne voit pas très bien comment la vie pourrait ne pas se poursuivre ainsi, interminable et ennuyeuse, si Kader ne jetait les yeux sur Marie. La réticence même de la jeune fille montre à l’évidence qu’elle n’est pas insensible au regard du garçon, qui lui paraît peut-être un peu moins grossier que Freddy, mais qui, surtout, ne trimballe pas avec lui une cohorte de crétins ricaneurs et salaces.
On ne voit pas très bien comment la vie pourrait ne pas se poursuivre ainsi, interminable et ennuyeuse, si Kader ne jetait les yeux sur Marie. La réticence même de la jeune fille montre à l’évidence qu’elle n’est pas insensible au regard du garçon, qui lui paraît peut-être un peu moins grossier que Freddy, mais qui, surtout, ne trimballe pas avec lui une cohorte de crétins ricaneurs et salaces.
 On devine bien que l’assiduité de Kader va précipiter les événements et il est inutile de dire comment. Mais sur le fond de l’intrigue le réalisateur n’oublie pas de proposer de fines notations ; ainsi ce soir d’été trop chaud où, le long de la rue, les habitants ont sorti chaises et tabourets pour prendre le frais ; ainsi les saletés de la bande de Freddy qui, après une répétition de la fanfare couplée avec un entraînement de majorettes, tripote et humilie une gamine courtaude et joufflue, pour rien, simplement pour rigoler.
On devine bien que l’assiduité de Kader va précipiter les événements et il est inutile de dire comment. Mais sur le fond de l’intrigue le réalisateur n’oublie pas de proposer de fines notations ; ainsi ce soir d’été trop chaud où, le long de la rue, les habitants ont sorti chaises et tabourets pour prendre le frais ; ainsi les saletés de la bande de Freddy qui, après une répétition de la fanfare couplée avec un entraînement de majorettes, tripote et humilie une gamine courtaude et joufflue, pour rien, simplement pour rigoler.
 Dumont, après le drame que l’on devine, ne sait pas trop comment terminer son film ; de fait il ne le termine pas : la dernière image, c’est Freddy allongé dans l’herbe, au fin fond de la campagne, les yeux vagues, les yeux perdus.
Dumont, après le drame que l’on devine, ne sait pas trop comment terminer son film ; de fait il ne le termine pas : la dernière image, c’est Freddy allongé dans l’herbe, au fin fond de la campagne, les yeux vagues, les yeux perdus.