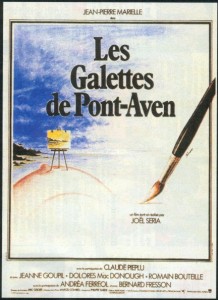
Étonnant !
Joël Séria est un réalisateur si inclassable que, malgré l’immense succès public des Galettes de Pont-Aven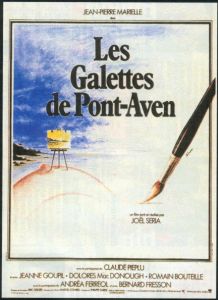 et un choix de sujets et de thèmes qui, au moins en apparence, pouvaient paraître flatter le cochon qui sommeille, il n’a plus tourné de vrai film depuis vingt ans, et que la véritable expression de ses obsessions et de ses prédilections remonte plus loin encore.
et un choix de sujets et de thèmes qui, au moins en apparence, pouvaient paraître flatter le cochon qui sommeille, il n’a plus tourné de vrai film depuis vingt ans, et que la véritable expression de ses obsessions et de ses prédilections remonte plus loin encore.
 Revoir une nouvelle fois ces Galettes
Revoir une nouvelle fois ces Galettes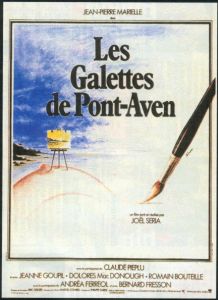 -là, si multidiffusées à la télévision qu’elle font partie d’une sorte de patrimoine commun m’a pourtant donné envie de découvrir Charlie et ses deux nénettes
-là, si multidiffusées à la télévision qu’elle font partie d’une sorte de patrimoine commun m’a pourtant donné envie de découvrir Charlie et ses deux nénettes , Comme la Lune
, Comme la Lune ou – si je le trouve ! – Les deux crocodiles
ou – si je le trouve ! – Les deux crocodiles ; pourquoi ? parce qu’il y a un œil juste, des dialogues étincelants, des acteurs grandioses, des situations rares.
; pourquoi ? parce qu’il y a un œil juste, des dialogues étincelants, des acteurs grandioses, des situations rares.
Séria, c’est, un type plein de verve et de choses à dire, mais qui se soucie des spectateurs, de l’histoire, de l’épaisseur du jeu des acteurs ; c’est, finalement, ce qu’aurait pu être, d’une certaine façon, Mocky , s’il avait eu un peu moins d’indifférence pour les gens, moins de désinvolture et de je-m’en-foutisme.
, s’il avait eu un peu moins d’indifférence pour les gens, moins de désinvolture et de je-m’en-foutisme.
 Les galettes
Les galettes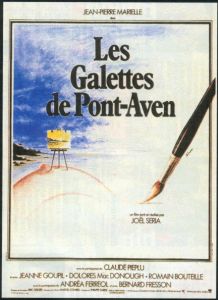 , c’est un film irrespectueux, tonitruant, baroque, bouffi d’excès quelquefois, mais toujours attachant, toujours dirigé. L’histoire d’un type qui voit dans les femmes, et surtout dans leur cul la raison principale de vivre, comme Courbet y voyait L’origine du monde
, c’est un film irrespectueux, tonitruant, baroque, bouffi d’excès quelquefois, mais toujours attachant, toujours dirigé. L’histoire d’un type qui voit dans les femmes, et surtout dans leur cul la raison principale de vivre, comme Courbet y voyait L’origine du monde , comme Charles Denner
, comme Charles Denner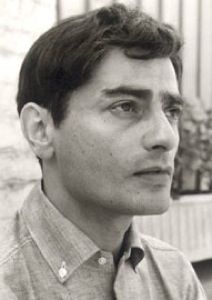 en était fasciné, dans le film
en était fasciné, dans le film de Truffaut
de Truffaut (Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie). Le dialogue, très écrit, de Séria lui-même est plein de répliques d’anthologie, de monologues si tonitruants qu’ils évoquent le ton d’Audiard
(Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie). Le dialogue, très écrit, de Séria lui-même est plein de répliques d’anthologie, de monologues si tonitruants qu’ils évoquent le ton d’Audiard , un Audiard
, un Audiard qui serait moins pudique, plus luxurieux, plus charnel.
qui serait moins pudique, plus luxurieux, plus charnel.
Est-ce graveleux, salace, rabelaisien, tout cela ? À vision superficielle, peut-être (et je ne suis pas sûr de n’avoir pas eu, jadis, cette vision-là, joyeuse, épicurienne, gaillarde), alors que c’est davantage une inquiétude et un magnétisme : le sexe n’y est pas qu’aimable, il est anxieux et fascinant, moins pour la jouissance qu’il donne que pour l’émerveillement esthétique.
 Rien d’ennuyeux, pourtant, ou de théorisé, dans une histoire invraisemblable et délicieuse, ponctuée de morceaux de bravoure éclatants, si outrés et si forts qu’ils étonnent à chaque fois : Henri Serin (Jean-Pierre Marielle
Rien d’ennuyeux, pourtant, ou de théorisé, dans une histoire invraisemblable et délicieuse, ponctuée de morceaux de bravoure éclatants, si outrés et si forts qu’ils étonnent à chaque fois : Henri Serin (Jean-Pierre Marielle , absolument grandiose) présentant sa collection de parapluies, au lit avec Andréa Ferréol
, absolument grandiose) présentant sa collection de parapluies, au lit avec Andréa Ferréol , accueilli par le frère (Claude Piéplu
, accueilli par le frère (Claude Piéplu ) et la sœur (Martine Ferriere), également cinglés, rencontrant Émile, le peintre roublard et obsédé (Bernard Fresson
) et la sœur (Martine Ferriere), également cinglés, rencontrant Émile, le peintre roublard et obsédé (Bernard Fresson , également magnifique), contemplant le cul superbe d’Angéla (Dolores McDonough) et décidant de le peindre obsessionnellement, se bourrant le pif au gwin ru dans le bistro de Pont-Aven, tâchant d’obtenir une passe gratuite de Marie Pape (singulière, inattendue, Dominique Lavanant
, également magnifique), contemplant le cul superbe d’Angéla (Dolores McDonough) et décidant de le peindre obsessionnellement, se bourrant le pif au gwin ru dans le bistro de Pont-Aven, tâchant d’obtenir une passe gratuite de Marie Pape (singulière, inattendue, Dominique Lavanant ), chantant le Kénavo du réactionnaire Théodore Botrel lors de la kermesse organisée par le curé du bourg (trogne de Romain Bouteille, si rarement bien utilisé par le cinéma : il est un des deux activistes OAS rencontrés par Alain Leroy dans Le feu follet
), chantant le Kénavo du réactionnaire Théodore Botrel lors de la kermesse organisée par le curé du bourg (trogne de Romain Bouteille, si rarement bien utilisé par le cinéma : il est un des deux activistes OAS rencontrés par Alain Leroy dans Le feu follet , au Flore)…
, au Flore)…
C’est en tout cas un film étonnant, durable, inhabituel, une des rares incursions françaises dans le ton doux-amer d’ordinaire apanage de la comédie italienne. Ce qui, à mes yeux, n’est pas un mince compliment.