 La classification des cryptogames.
La classification des cryptogames.
C’est au 14 rue Girardon, à Montmartre, que Jean-Paul Le Chanois a logé la famille Langlois de ses deux films, Papa, Maman, la bonne et moi
a logé la famille Langlois de ses deux films, Papa, Maman, la bonne et moi et sa suite, Papa, Maman, ma femme et moi
et sa suite, Papa, Maman, ma femme et moi (faut-il vraiment préciser aux jeunes générations qui ne connaissent pas ce délicieux duo que, au fil du récit, la bonne est devenue ma femme ?). Rue Girardon, dans un haut immeuble à vue exceptionnelle sur Paris, rue Girardon où (me souffle Wikipédia), Louis-Ferdinand Céline
(faut-il vraiment préciser aux jeunes générations qui ne connaissent pas ce délicieux duo que, au fil du récit, la bonne est devenue ma femme ?). Rue Girardon, dans un haut immeuble à vue exceptionnelle sur Paris, rue Girardon où (me souffle Wikipédia), Louis-Ferdinand Céline a habité, où Jean Renoir
a habité, où Jean Renoir est né, rue Girardon qui longe la place Marcel Aymé
est né, rue Girardon qui longe la place Marcel Aymé et le Moulin de la Galette et croise la place Dalida
et le Moulin de la Galette et croise la place Dalida …
…
Sous de pareils auspices, voici un double bijou dont l’un ne peut être dissocié de l’autre, le premier étant à peine supérieur de qualité au second (et la chose est assez rare pour être mentionnée). L’un et l’autre film bénéficient des talents de scénaristes de Pierre Véry, l’auteur des Disparus de Saint-Agil,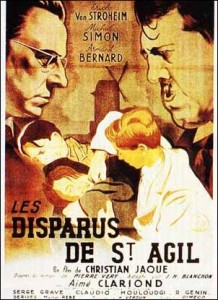 de Goupi mains-rouges
de Goupi mains-rouges et de L’assassinat du Père Noël
et de L’assassinat du Père Noël et du grand Marcel Aymé
et du grand Marcel Aymé : on ne saurait trouver meilleurs patronages.
: on ne saurait trouver meilleurs patronages.
Sur le fil de Papa, Maman, la bonne et moi, j’ai abondamment évoqué ce que pouvaient être la vie d’un immeuble parisien du début des années cinquante et le quotidien d’une bourgeoisie très consciente de sa situation sociale, mais aux revenus extrêmement modestes, en un temps où on ne parlait jamais de développement personnel et constamment d’économies. (Naturellement, économies, au pluriel, celles que l’on faisait sou par sou ; l’Économie, la grande, la nationale, l’internationale, celle dont on nous rebat aujourd’hui les oreilles, à proportion qu’on ne peut rien à sa marche, fonctionnait, pour sa part, admirablement bien, sans qu’on l’évoquât jamais).
j’ai abondamment évoqué ce que pouvaient être la vie d’un immeuble parisien du début des années cinquante et le quotidien d’une bourgeoisie très consciente de sa situation sociale, mais aux revenus extrêmement modestes, en un temps où on ne parlait jamais de développement personnel et constamment d’économies. (Naturellement, économies, au pluriel, celles que l’on faisait sou par sou ; l’Économie, la grande, la nationale, l’internationale, celle dont on nous rebat aujourd’hui les oreilles, à proportion qu’on ne peut rien à sa marche, fonctionnait, pour sa part, admirablement bien, sans qu’on l’évoquât jamais).
En tout cas, hors quelques rares scories, quelques gags un peu faciles, le scénario est d’une grande finesse, constamment bienveillant envers ses personnages, d’une tendresse qui s’harmonise bien avec la France de 1956, râleuse, grognonne et mécontente (comme depuis toujours, depuis qu’elle existe) mais où les restrictions de la guerre étaient oubliées et où l’avenir apparaissait radieux. Ce n’est pas parce que j’écris cela que je fais mine de négliger que Dien-Bien-Phu n’était pas si loin, que la guerre d’Algérie avait commencé, que le rideau de fer s’était abattu, que la IVème République nous ridiculisait aux yeux du monde, etc. Mais on était tout de même certain que la génération qui suivait vivrait mieux que la génération précédente.
Pourtant, il y a quelque chose qui subsiste et qui est d’une grise permanence depuis soixante ans : la crise du logement. Traitée avec esprit et légèreté, elle est le ressort comique de Papa, Maman, ma femme et moi, dont les péripéties vont habilement tourner autour des difficultés de cohabitation des parents Langlois (Fernand Ledoux
dont les péripéties vont habilement tourner autour des difficultés de cohabitation des parents Langlois (Fernand Ledoux et Gaby Morlay)
et Gaby Morlay) et du jeune couple (Robert Lamoureux
et du jeune couple (Robert Lamoureux et Nicole Courcel)
et Nicole Courcel) , à qui vont s’ajouter au fil des ans deux paires de jumeaux dont les premiers – des garçons – sont de turbulents sacripants. Vivre à huit dans l’appartement de la rue Girardon, même augmenté de la chambre de bonne, devient source de frictions, d’agacements, d’incompréhensions encore enluminées par la différence de génération. Il y a en tout cas de succulentes saynètes, de petits moments de jubilation attendrie où tout le parfum de l’époque se retrouve.
, à qui vont s’ajouter au fil des ans deux paires de jumeaux dont les premiers – des garçons – sont de turbulents sacripants. Vivre à huit dans l’appartement de la rue Girardon, même augmenté de la chambre de bonne, devient source de frictions, d’agacements, d’incompréhensions encore enluminées par la différence de génération. Il y a en tout cas de succulentes saynètes, de petits moments de jubilation attendrie où tout le parfum de l’époque se retrouve.
Comme on ne peut pas tourner tout un film d’1h45 là-dessus, les scénaristes ont introduit deux éléments périphériques : d’abord la course vers ce qui fut une aspiration immense de Français, la maison de campagne, qu’on baptisera, vers 1970, la résidence secondaire ; c’est peut-être la partie la moins réussie du film, parce qu’elle est un peu trop satirique, même si Louis de Funès,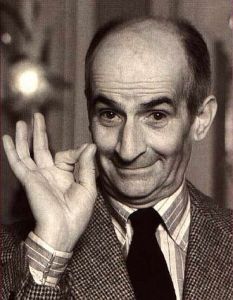 Jean Tissier
Jean Tissier et Marcel Pérès
et Marcel Pérès y jouent d’assez drôles séquences.
y jouent d’assez drôles séquences.
Deuxième élément, les petits égarements sentimentaux, très joliment traités, avec beaucoup d’esprit et de cœur, et même de l’émotion lorsque Gabrielle Langlois (Gaby Morlay) dont l’esprit s’est laissé un peu égarer par un sage ethnologue (Michel Etcheverry) se reprend (bien avant d’avoir sauté le pas, bien avant !) tout en souriant à la chaste aventure où, pour la dernière fois, ainsi qu’elle dit, elle a vu un homme amoureux. C’est charmant.
dont l’esprit s’est laissé un peu égarer par un sage ethnologue (Michel Etcheverry) se reprend (bien avant d’avoir sauté le pas, bien avant !) tout en souriant à la chaste aventure où, pour la dernière fois, ainsi qu’elle dit, elle a vu un homme amoureux. C’est charmant.
Comme est habile le quiproquo qui met un peu en péril le jeune couple et où Robert (Lamoureux, évidemment) est à deux doigts de tromper Catherine (Nicole Courcel)
évidemment) est à deux doigts de tromper Catherine (Nicole Courcel) avec une séduisante fleuriste (Elina Labourdette)
avec une séduisante fleuriste (Elina Labourdette) avant de se reprendre. On peut trouver ça redoutablement moral et prêcher une sexualité libérée. Je ne suis pas persuadé que ça donne bien davantage de bonheur.
avant de se reprendre. On peut trouver ça redoutablement moral et prêcher une sexualité libérée. Je ne suis pas persuadé que ça donne bien davantage de bonheur.
Ah ! Encore un mot ! Un hommage d’admiration à la grande, l’immense Gabrielle Fontan, une de ces grandes actrices laides qui ont fait le cinéma français, mais qui est, à mon sens, bien meilleure que Pauline Carton
une de ces grandes actrices laides qui ont fait le cinéma français, mais qui est, à mon sens, bien meilleure que Pauline Carton ou Jeanne Fusier-Gir,
ou Jeanne Fusier-Gir, du niveau de Marguerite Moreno
du niveau de Marguerite Moreno ; il faut voir comment, avec une méchanceté vipérine elle signifie à Fernand Ledoux
; il faut voir comment, avec une méchanceté vipérine elle signifie à Fernand Ledoux que l’institution privée où il enseigne ne veut plus de lui… Une séquence de trois ou quatre minutes qui justifierait presque à elle seule qu’on regarde Papa, Maman, ma femme et moi.
que l’institution privée où il enseigne ne veut plus de lui… Une séquence de trois ou quatre minutes qui justifierait presque à elle seule qu’on regarde Papa, Maman, ma femme et moi.


