 C’était il y a mille ans.
C’était il y a mille ans.
J’ai toujours entendu présenter Paris 1900, film de montage de Nicole Vedrès comme la plus belle illustration au cinéma de ce que furent les quatorze premières années du siècle, similaire dans le domaine de la littérature à Comment j’ai vu 1900 de la Comtesse Jean de Pange ou 1900 de Paul Morand. Une sorte de bijou qui a conté ce qu’on a appelé La belle époque, qui l’est devenue tant et tant à la suite des sidérations d’horreur qu’ont été les deux guerres mondiales, celles qui ont fait exploser le monde stable, fier de lui-même, conscient de son opulence et croyant en sa stabilité, en son immuabilité, même. Expression presque incantatoire qui a figé une période bien plus compliquée qu’il n’apparaît.
 Nicole Vedrès a rassemblé et monté la substance de quelque 700 métrages très divers, réalisés par quelques professionnels et de très nombreux quidams, touchant à peu près tous les domaines de l’époque. Film de montage à l’extraordinaire fluidité et à l’intelligence toujours aux aguets, qui déroule le panorama à peu près exhaustif de ce que fut ce monde qui disparut le 28 juin 1914, lors de l’attentat de Sarajevo et un peu plus d’un mois plus tard avec la déclaration de guerre.
Nicole Vedrès a rassemblé et monté la substance de quelque 700 métrages très divers, réalisés par quelques professionnels et de très nombreux quidams, touchant à peu près tous les domaines de l’époque. Film de montage à l’extraordinaire fluidité et à l’intelligence toujours aux aguets, qui déroule le panorama à peu près exhaustif de ce que fut ce monde qui disparut le 28 juin 1914, lors de l’attentat de Sarajevo et un peu plus d’un mois plus tard avec la déclaration de guerre.
Ce qui est remarquable dans le film, ce n’est pas la variété ou l’originalité des images montrées. La télévision, friande de rétrospectives et de reconstitutions, a à peu près exhumé tout ce qui pouvait dormir dans les archives de Gaumont ou de Pathé et il y a peu de séquences que nous n’ayons déjà vues, légères ou dramatiques, profondes ou sarcastiques.
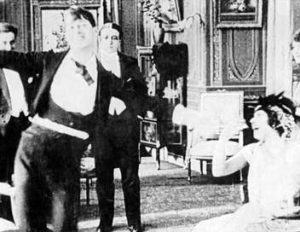
Ce qui est beaucoup plus exceptionnel, c’est la fluidité de ce montage et la compréhension profonde de ce monde qui oscille encore entre plusieurs orientations. Un monde qui demeure encore profondément traditionnel mais qui est irrigué par des courants nouveaux : Pablo Picasso, Georges Braque inventent le cubisme vers 1907, Igor Stravinski étonne la musique dès L’oiseau de feu en 1910 et plus encore avec Le sacre du printemps en 1913, Guillaume Apollinaire publie L’enchanteur pourrissant en 1910 et Alcools en 1913. Le style Art nouveau étonne Paris des efflorescences des bouches de métro conçues par Hector Guimard et des immeubles de Jules Lavirotte.

Et en même temps, parfaite illustration du monde bien élevé de La recherche du temps perdu, les réunions mondaines, les calèches qui se pressent dans les allées du Bois de Boulogne, la solennité des grands mariages à La Madeleine, la physionomie des dandys grands séducteurs, Boni de Castellane, Robert de Montesquiou, Hélie de Talleyrand-Périgord et des ravageuses courtisanes Caroline Otéro, Liane de Pougy, Cléo de Mérode… La duchesse d’Uzès, Paul Bourget, Maurice Barrès, les actrices Réjane, Sarah Bernhardt, Cécile Sorel, l’acteur Mounet-Sully, les artistes Auguste Renoir, Claude Monet, Auguste Rodin…mais aussi les grands sportifs, Jean Bouin l’athlète ou Georges Carpentier le boxeur…
 On passe des uns aux autres avec une souveraine souplesse qui, mieux que toute anthologie thématique donne une photographie qu’on imagine aussi exacte – en tout cas aussi significative – que peut être aujourd’hui la lecture d’un quotidien dont les pages sont emplies des propos des hommes politiques, des vicissitudes de la conjoncture internationale, des faits divers les plus singuliers, des émois de vedettes du show-business, des exploits des champions…. et même de la météorologie, comme le sont dans Paris 1900 les désastres de la crue de 1910…
On passe des uns aux autres avec une souveraine souplesse qui, mieux que toute anthologie thématique donne une photographie qu’on imagine aussi exacte – en tout cas aussi significative – que peut être aujourd’hui la lecture d’un quotidien dont les pages sont emplies des propos des hommes politiques, des vicissitudes de la conjoncture internationale, des faits divers les plus singuliers, des émois de vedettes du show-business, des exploits des champions…. et même de la météorologie, comme le sont dans Paris 1900 les désastres de la crue de 1910…

Au fait, il est inutile de me dire vertueusement qu’il y avait de la misère et de l’injustice derrière les superbes paravents déployés par la vie mondaine, le théâtre et le music-hall de l’époque, derrière les querelles byzantines sur la disparition du corset et la taille des chapeaux. Je le sais bien.
Nicole Vedrès empile un peu trop à la fin de son film ces misères et ces injustices et entonne un petit couplet révolté qui gâche un peu son propos. On sait bien que la société danse sur un volcan – comme à peu près toutes les sociétés, au demeurant, car ce qui est étonnant, ce n’est pas le désordre, mais l’ordre comme disait mon vieux maître Charles Maurras. N’empêche que la folle destruction de cet ordre injuste nous a conduit vingt ans plus tard à tutoyer l’Enfer et que nous ne nous en sommes toujours pas remis. D’ailleurs, en voyant les images de l’assaut donné par les forces de police à la ferme où se sont réfugiés les derniers assassins de la Bande à Bonnot, ne songe-t-on pas aux chaînes d’information en continu qui braquent leurs caméras lors d’un attentat islamiste ?